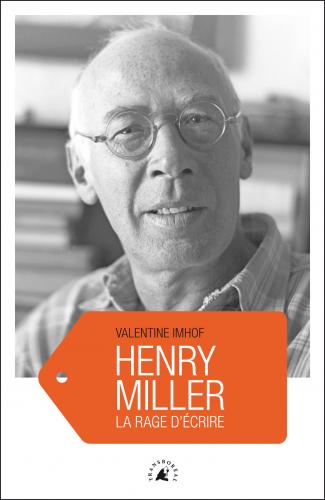
Henry Miller, La rage d’écrire
Valentine Imhof
Paradoxalement, peu d’écrivains semblent aussi méconnus qu’Henry Miller. On sait généralement qu’il est l’auteur d’une poignée de romans au contenu sexuel explicite et obscène, sa liaison torride avec Anaïs Nin a fait l’objet d’un film dans les années 1990, et on lui attribue, parfois, une paternité dans l’émergence de la Beat Generation et des mouvements de la contre-culture américaine des années 1960? Voilà à quoi semble se résumer Henry Miller, et cela quand on ne fait pas l’erreur de le confondre avec son homonyme Arthur? Or, ces quelques lieux communs, réducteurs et approximatifs, masquent l’une des figures majeures de la littérature américaine du XXe siècle dont la prose, éruptive et flamboyante, sait épouser les méandres et les contradictions d’un esprit original, subversif, cultivé et profondément humain.
Pour Henry Miller, tout commence par une immense déception. Nourri de Thoreau, Whitman et London, il rêve, adolescent, de nature et de grands espaces et souhaite se confronter à l’Amérique mythique et éternelle, celle des chasseurs de bisons, des trappeurs et des chercheurs d’or. Mais il a vite le sentiment d’être né trop tard, se sent exilé à New York, sans racines dans une ville grise et monstrueuse qui a pour lui la dureté et la froideur d’un cachot, et il ne voit pas où est sa place dans cette société du début du XXe siècle qui a pour valeurs réussite matérielle, production de masse, profit et consommation effrénés. Dès lors, convaincu de son inadéquation intrinsèque, d’un décalage irrémédiable, qu’il éprouve même au sein de sa famille, il refuse de devenir un rouage de la machine, un citoyen, un fils, un époux modèles et de se conformer aux attentes, d’où qu’elles viennent. Il n’assure pas la reprise de la boutique paternelle, rejette l’esclavage organisé qu’est pour lui le monde du travail et crache sur les promesses de faux bonheurs achetés à crédit et vantés par les enseignes. Et, un jour de 1922, « flemmard » autoproclamé, il décide, après plus de trente ans de désabusement et de dilettantisme professionnel – qui lui ont fait exercer des dizaines d’emplois précaires –, de devenir écrivain. Écrire, sinon rien, écrire coûte que coûte, puisque tout le reste a lamentablement échoué, écrire pour échapper à la folie et peut-être à la mort, écrire pour saisir le monde à bras-le-corps, écrire pour s’éprouver et tenter de comprendre qui il est.
Il se lance dans cette ultime échappatoire avec l’énergie et la rage du désespéré. L’écriture devient une lutte de chaque instant, un combat vital pour celui qui a associé de manière étroite « écrire » et « vivre ». Et la persévérance dont il fait preuve est alors admirable. Sa vie devient une course de fond, doublée d’un parcours du combattant, tant sont nombreux les obstacles qui contrarient l’accomplissement du destin qu’il décide de se forger.
Autodidacte, Henry Miller est avant tout un lecteur prodigieux, vorace. La compagnie des livres lui permet de chercher les écrivains dans leurs œuvres et de trouver sa place parmi eux, de s’inscrire dans une généalogie littéraire, de se constituer une famille, dont il choisit les membres, dans laquelle il peut avoir plusieurs pères, plusieurs frères et quelques sœurs, de tout âge, de toute époque, de toute culture et de tout continent, avec qui les affinités sont évidentes et tellement plus grandes que celles imposées par la filiation biologique. Mais il arrive aussi que ses enthousiasmes littéraires le submergent et que ses figures tutélaires (Proust, Hamsun, Dostoïevski, Rimbaud, etc.) l’écrasent et le laissent, désemparé, face à sa propre incapacité. À New York, l’écriture se refuse, ou du moins ne se donne pas tout de suite. Trop d’impatience, trop de frustrations affectives et matérielles, un trop grand besoin de reconnaissance immédiate. Il lui faut plus de dix ans de tâtonnements et surtout un départ à Paris avec quelques dollars en poche pour enfin trouver sa voix, ce « je » qui lance un défi tonitruant à la littérature, à l’art et à Dieu dès les premières pages de Tropique du Cancer. Henry Miller a alors 43 ans mais le combat ne fait que commencer parce qu’il doit ensuite batailler pour être édité et surtout lu. En effet, pendant plusieurs décennies, les censeurs condamnent ses œuvres pour obscénité, en interdisent la vente et contribuent à construire l’image du personnage sulfureux qu’il est encore.
Le mal est fait, du moins le malentendu car, d’une certaine manière, Miller ne s’est jamais réellement remis de ce succès de scandale, qu’il n’avait ni anticipé ni voulu, mais dont il avait, en revanche, pressenti les dommages : l’accent mis sur quelques pages de quelques ouvrages seulement l’a installé au rayon des écrivains licencieux pourvoyeurs de sous-littérature et a fait perdre de vue l’auteur, au plein sens du terme, et le caractère à la fois unique et multiple de son œuvre, qui compte des dizaines de romans, essais et nouvelles, sans mentionner sa correspondance.
Jusqu’au bout, on sent chez Henry Miller un besoin de reconnaissance et une fragilité, que ne vient pas combler sa notoriété soudaine qui arrive pour de mauvaises raisons et trop tard. Tout cela l’accable et ne répond pas à la question angoissée qui le taraude depuis ses débuts : « Suis-je vraiment un écrivain ? » Alors, lui qui s’est toujours révélé hors système, hors idéologie, hors establishment, tente à près de 90 ans, d’obtenir une légitimation en convainquant nombre de ses amis écrivains et éditeurs de se mobiliser pour contacter l’académie suédoise en sa faveur? Mais le prix Nobel de littérature 1978 lui échappe? Et Henry Miller meurt l’année suivante, deux jours avant la parution de son dernier livre, une somme sensible et éclairée sur l’écrivain anglais D. H. Lawrence, qu’il avait commencé à écrire à Paris, plus de quatre décennies auparavant?
Créateur infatigable et iconoclaste, Henry Miller a choisi de chanter la vie, de chanter sa vie, même dans ses manifestations les plus triviales. Sa voix singulière, son ton familier, sa verve érudite, sa faconde débridée, son entrain irrésistible séduisent et ses textes, empreints de sa présence généreuse et de sa bonne humeur communicative, semblent ne pas vieillir, surtout quand il s’agit de dénoncer les excès de notre société et de s’en indigner, certes, mais aussi de les rendre moins nocifs en leur opposant la force du rire et en conservant la capacité d’admirer les merveilles que recèle encore notre monde.


