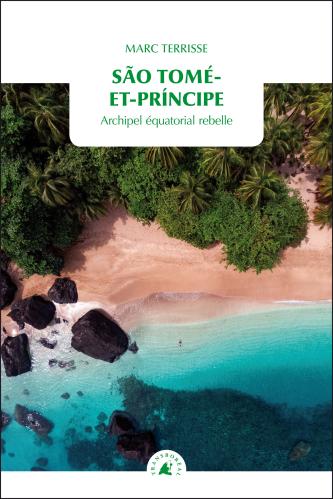
Sur la route de Santa Catarina :
« Sur ces entrefaites propres à mon expérience, le pêcheur me confirme qu’il n’y a presque que des pêcheurs angolares dans la région. Il se focalise sur le poisson et affirme qu’en quinze ans de carrière il n’a jamais vu un spécimen comme celui qu’il vient de me montrer, une espèce hybride, mutante ou issue des profondeurs et venue par hasard dans des eaux moins denses. En bon commerçant, il me propose quelques maquereaux pour le dîner. Je refuse poliment, faute de pouvoir les transporter et les cuisiner dans l’immédiat. “Vous devriez en profiter, le poisson se fait rare. La pêche devient de plus en plus difficile, vous savez. Mon fils n’a pas voulu faire ce métier. Il a été obligé de partir à Príncipe pour trimer dans une roça ouverte par le milliardaire sud-africain dont tout le monde parle. Ce Monsieur possède trois complexes du même genre et il en a ouvert un à São Tomé, je crois. Le prix de la chambre équivaut à trois mois de salaire voire plus. A Roça Sundi, où travaille mon garçon, appartenait autrefois à la famille royale portugaise et il y a maintenant un nouveau roi sur l’île. C’est le comble pour un pays qui a été marxiste il n’y a pas si longtemps. On pourrait presque en faire un tchiloli ! Je fais au passage du tchiloli si ça vous dit. J’ai joué aussi bien l’impératrice que le prince Charles, figurez-vous. Et sinon, d’où venez-vous comme ça ?” Mon lieu de séjour et ma trajectoire le poussent à m’applaudir. “Vous êtes courageux ! Vous entendez ça, vous autres : ce Monsieur vient de France, il séjourne à São Tomé et il est venu à vélo jusqu’ici, chapeau bas. Je ne vous embête pas plus et vous souhaite bonne route.” Ses camarades pêcheurs me félicitent à leur tour et m’adressent leurs meilleurs vœux pour la suite de mon séjour.
Assez vite, la petite ville de Neves apparaît au loin. Elle propose un décor assez différent de ce que j’ai pu entrevoir jusqu’à présent. Une usine annonce la couleur. L’industrie, plutôt discrète dans le reste de l’île, est ici on ne peut plus visible. Ce n’est pas très seyant pour une ville d’avoir des cheminées qui fument, mais cela apporte quelques richesses et du travail, bien que les emplois dans ce secteur et tout spécialement ici à São Tomé-et-Príncipe ne soient pas la panacée. Je croise une raffinerie puis une brasserie qui affiche le nom de la Rosema, la bière locale qui a inondé tout l’archipel.
Un incoercible désir de désaltération me saisit. De grandes et belles affiches vantent les mérites de la boisson nationale sur fond de paysage tropical, voilà que je me sens influencé par ces publicités – la propagande, quand elle est bien conçue, est redoutable ! La preuve, je fais une halte à la terrasse du premier troquet venu, habillé de chaises en plastique vertes et de nappes en papier blanc. Depuis mon observatoire surplombant la mer, je déguste la cervoise du cru et craque pour des rougets grillés accompagnés de frites maison comme on n’en fait plus, le tout apporté avec style et célérité par un garçon des plus taciturne. Sur mon siège à moitié cassé, j’ai l’impression d’être le roi du monde, de jouir d’un moment de simplicité festive, profitant des largesses d’un dieu des petits riens, pour reprendre le nom d’un célèbre roman indien.
L’écho de la corne de brume retentit subitement et détériore quelque peu l’atmosphère paisible. Mes oreilles sifflent, je me crois devenu encore plus sourd qu’avant. La barbe, si ça continue, je suis bon pour m’équiper d’un sonotone ! Contrarié, j’identifie la cause de mes tourments : d’incessants allers et retours de gros bateaux de marchandises. Ils témoignent d’une activité sans comparaison avec celle du port de la capitale. Mes voisins de tablée, qui viennent de s’installer, ne semblent pas avoir récolté les fruits de cette économie industrialo-portuaire. Mal rasés, mal fagotés, le visage bouffi et le dentier copieusement dégarni par la conjugaison des maléfices du tabac et de l’alcool, je capte des bribes de leur dissertation théâtrale sur les résultats du derby Benfica-Sporting joué la veille à Lisbonne.
L’un deux, la voix pâteuse mais désinhibé par l’abus de chope de houblon, m’observe en train de compter les navires. Je vis dans la sainte horreur d’être surveillé et abrège mon inventaire, manière de dénigrer ce que j’étais en train de faire. Me pensant disponible, il m’aborde : “Ah, vous avez l’air d’aimer les bateaux, cher Monsieur. Nous tous, là, enfin, tous ceux qui sont là? eh ben, on a été dockers, embauchés pour un salaire de misère jusqu’à ce qu’on nous vire comme des malpropres. Et maintenant, ils vont agrandir le port, faire un énorme truc pour accueillir les gros conteneurs. On espérait qu’ils allaient nous embaucher, qu’on allait pouvoir retrouver du boulot. Sauf que c’est les Chinois qui paient et ils emploient d’autres Chinois sur le port. Ils disent qu’on est des fainéants, qu’on coûte trop cher. Alors, ils nous laissent sur le carreau. Vous trouvez ça normal ? C’est révoltant, non ?” Interdit par cette apostrophe, je ne peux que compatir. Je me mets à la place de ces hommes voués aux gémonies. Ce sentiment d’être mis de côté, je l’ai ressenti pas mal de fois dans ma vie professionnelle. Et un confrère pilier de bar de renchérir : “On retourne au temps des plantations avec les Portugais !” La messe est dite. Je me lève, paie mon dû au patron tout aussi dépendant à la boisson que sa clientèle, salue le très discret garçon tiré à quatre épingles et m’adresse aux laissés pour compte du miracle chinois en décochant une petite phrase qui me vaut un tonnerre d’applaudissements : “Il vous faut un nouveau roi Amador.”
Je dépasse Neves et ses rêves rouillés d’industrie, laissant derrière moi les fumées des cheminées d’usine et les notes soufrées de la pétrochimie digne de la New York stalinienne havraise. La surface de la chaussée plissée, perforée, bombardée par les sanglots de cumulonimbus hyperémotifs enraie mon évolution vers A Roça Diogo Vaz. La vigilance est de mise pour éviter une chute potentiellement grave. La clavicule, l’omoplate ou le poignet sont le talon d’Achille du cycliste. Les fractures vont bon train dès que survient une embardée.
Au milieu de bananiers démonstratifs, un panneau en forme de flèche indique Monte Forte. Ce nom me fait tressaillir et augure de difficultés à venir. J’appréhende une rampe courte et ardue sur ce ruban peu praticable. Je m’économise, m’attendant au pire. Mais rien ne vient, la pente ne raidit pas, elle reste faussement plate, presque indolore pour les mollets, rabotée et adoucie par quelques courbes bénignes.
Évolution du décor. Dans le petit village d’Esperinha, la croûte viaire se métamorphose. Les tressautements qui brutalisaient mes reins, remontant jusqu’à ma nuque comme des microséismes, ont disparu. Mes roues tournent sur un tapis roulant, un tatami, un billard, un Wimbledon que des cantonniers ont bichonné comme un jardin à la française. Une largesse extrême-orientale ? Un potentat local aux bras aussi longs que ses dents ? Rien n’indique l’origine de l’acte d’évergète. Mon dos et mes articulations lui sont redevables.
Je relance en danseuse, prends de la vitesse, stabilise mon allure, me penche dans les virages comme un motard dans un Grand Prix, quand surgit un contingent de cochons noirs depuis les bosquets. Automatisme de survie, j’écrase avec mes doigts le frein, les pneus crissent, je me contorsionne et déchausse pour éviter la mère qui guide ses quatre petits, tous imperturbables. C’était moins une, le carambolage est évité de justesse. Mon cœur bat fort, l’émotion posttraumatique se manifeste. Je frotte mon avant-bras sur mon front suintant, expire à plusieurs reprises pour rejeter la tension. J’hésite à repartir avec mon vélo chahuté mais intact. Ne pas reprendre du service me couperait les ailes pour de bon. Je rembobine le film, le stocke dans ma mémoire et refoule le drame qui aurait pu se produire. Je serre les poings, rentre le ventre et cligne des yeux. La frayeur s’efface. Mon filet mignon de Pata Negra attendra. Clopin-clopant, je repars, dodeline des épaules, trotte comme si de rien n’était et m’aventure vers les zigzags qui strient le bord de mer. »
Nelson et Marta (p. 52-56)
Une histoire mouvementée (p. 130-135)
Extrait court
« Sur ces entrefaites propres à mon expérience, le pêcheur me confirme qu’il n’y a presque que des pêcheurs angolares dans la région. Il se focalise sur le poisson et affirme qu’en quinze ans de carrière il n’a jamais vu un spécimen comme celui qu’il vient de me montrer, une espèce hybride, mutante ou issue des profondeurs et venue par hasard dans des eaux moins denses. En bon commerçant, il me propose quelques maquereaux pour le dîner. Je refuse poliment, faute de pouvoir les transporter et les cuisiner dans l’immédiat. “Vous devriez en profiter, le poisson se fait rare. La pêche devient de plus en plus difficile, vous savez. Mon fils n’a pas voulu faire ce métier. Il a été obligé de partir à Príncipe pour trimer dans une roça ouverte par le milliardaire sud-africain dont tout le monde parle. Ce Monsieur possède trois complexes du même genre et il en a ouvert un à São Tomé, je crois. Le prix de la chambre équivaut à trois mois de salaire voire plus. A Roça Sundi, où travaille mon garçon, appartenait autrefois à la famille royale portugaise et il y a maintenant un nouveau roi sur l’île. C’est le comble pour un pays qui a été marxiste il n’y a pas si longtemps. On pourrait presque en faire un tchiloli ! Je fais au passage du tchiloli si ça vous dit. J’ai joué aussi bien l’impératrice que le prince Charles, figurez-vous. Et sinon, d’où venez-vous comme ça ?” Mon lieu de séjour et ma trajectoire le poussent à m’applaudir. “Vous êtes courageux ! Vous entendez ça, vous autres : ce Monsieur vient de France, il séjourne à São Tomé et il est venu à vélo jusqu’ici, chapeau bas. Je ne vous embête pas plus et vous souhaite bonne route.” Ses camarades pêcheurs me félicitent à leur tour et m’adressent leurs meilleurs vœux pour la suite de mon séjour.
Assez vite, la petite ville de Neves apparaît au loin. Elle propose un décor assez différent de ce que j’ai pu entrevoir jusqu’à présent. Une usine annonce la couleur. L’industrie, plutôt discrète dans le reste de l’île, est ici on ne peut plus visible. Ce n’est pas très seyant pour une ville d’avoir des cheminées qui fument, mais cela apporte quelques richesses et du travail, bien que les emplois dans ce secteur et tout spécialement ici à São Tomé-et-Príncipe ne soient pas la panacée. Je croise une raffinerie puis une brasserie qui affiche le nom de la Rosema, la bière locale qui a inondé tout l’archipel.
Un incoercible désir de désaltération me saisit. De grandes et belles affiches vantent les mérites de la boisson nationale sur fond de paysage tropical, voilà que je me sens influencé par ces publicités – la propagande, quand elle est bien conçue, est redoutable ! La preuve, je fais une halte à la terrasse du premier troquet venu, habillé de chaises en plastique vertes et de nappes en papier blanc. Depuis mon observatoire surplombant la mer, je déguste la cervoise du cru et craque pour des rougets grillés accompagnés de frites maison comme on n’en fait plus, le tout apporté avec style et célérité par un garçon des plus taciturne. Sur mon siège à moitié cassé, j’ai l’impression d’être le roi du monde, de jouir d’un moment de simplicité festive, profitant des largesses d’un dieu des petits riens, pour reprendre le nom d’un célèbre roman indien.
L’écho de la corne de brume retentit subitement et détériore quelque peu l’atmosphère paisible. Mes oreilles sifflent, je me crois devenu encore plus sourd qu’avant. La barbe, si ça continue, je suis bon pour m’équiper d’un sonotone ! Contrarié, j’identifie la cause de mes tourments : d’incessants allers et retours de gros bateaux de marchandises. Ils témoignent d’une activité sans comparaison avec celle du port de la capitale. Mes voisins de tablée, qui viennent de s’installer, ne semblent pas avoir récolté les fruits de cette économie industrialo-portuaire. Mal rasés, mal fagotés, le visage bouffi et le dentier copieusement dégarni par la conjugaison des maléfices du tabac et de l’alcool, je capte des bribes de leur dissertation théâtrale sur les résultats du derby Benfica-Sporting joué la veille à Lisbonne.
L’un deux, la voix pâteuse mais désinhibé par l’abus de chope de houblon, m’observe en train de compter les navires. Je vis dans la sainte horreur d’être surveillé et abrège mon inventaire, manière de dénigrer ce que j’étais en train de faire. Me pensant disponible, il m’aborde : “Ah, vous avez l’air d’aimer les bateaux, cher Monsieur. Nous tous, là, enfin, tous ceux qui sont là? eh ben, on a été dockers, embauchés pour un salaire de misère jusqu’à ce qu’on nous vire comme des malpropres. Et maintenant, ils vont agrandir le port, faire un énorme truc pour accueillir les gros conteneurs. On espérait qu’ils allaient nous embaucher, qu’on allait pouvoir retrouver du boulot. Sauf que c’est les Chinois qui paient et ils emploient d’autres Chinois sur le port. Ils disent qu’on est des fainéants, qu’on coûte trop cher. Alors, ils nous laissent sur le carreau. Vous trouvez ça normal ? C’est révoltant, non ?” Interdit par cette apostrophe, je ne peux que compatir. Je me mets à la place de ces hommes voués aux gémonies. Ce sentiment d’être mis de côté, je l’ai ressenti pas mal de fois dans ma vie professionnelle. Et un confrère pilier de bar de renchérir : “On retourne au temps des plantations avec les Portugais !” La messe est dite. Je me lève, paie mon dû au patron tout aussi dépendant à la boisson que sa clientèle, salue le très discret garçon tiré à quatre épingles et m’adresse aux laissés pour compte du miracle chinois en décochant une petite phrase qui me vaut un tonnerre d’applaudissements : “Il vous faut un nouveau roi Amador.”
Je dépasse Neves et ses rêves rouillés d’industrie, laissant derrière moi les fumées des cheminées d’usine et les notes soufrées de la pétrochimie digne de la New York stalinienne havraise. La surface de la chaussée plissée, perforée, bombardée par les sanglots de cumulonimbus hyperémotifs enraie mon évolution vers A Roça Diogo Vaz. La vigilance est de mise pour éviter une chute potentiellement grave. La clavicule, l’omoplate ou le poignet sont le talon d’Achille du cycliste. Les fractures vont bon train dès que survient une embardée.
Au milieu de bananiers démonstratifs, un panneau en forme de flèche indique Monte Forte. Ce nom me fait tressaillir et augure de difficultés à venir. J’appréhende une rampe courte et ardue sur ce ruban peu praticable. Je m’économise, m’attendant au pire. Mais rien ne vient, la pente ne raidit pas, elle reste faussement plate, presque indolore pour les mollets, rabotée et adoucie par quelques courbes bénignes.
Évolution du décor. Dans le petit village d’Esperinha, la croûte viaire se métamorphose. Les tressautements qui brutalisaient mes reins, remontant jusqu’à ma nuque comme des microséismes, ont disparu. Mes roues tournent sur un tapis roulant, un tatami, un billard, un Wimbledon que des cantonniers ont bichonné comme un jardin à la française. Une largesse extrême-orientale ? Un potentat local aux bras aussi longs que ses dents ? Rien n’indique l’origine de l’acte d’évergète. Mon dos et mes articulations lui sont redevables.
Je relance en danseuse, prends de la vitesse, stabilise mon allure, me penche dans les virages comme un motard dans un Grand Prix, quand surgit un contingent de cochons noirs depuis les bosquets. Automatisme de survie, j’écrase avec mes doigts le frein, les pneus crissent, je me contorsionne et déchausse pour éviter la mère qui guide ses quatre petits, tous imperturbables. C’était moins une, le carambolage est évité de justesse. Mon cœur bat fort, l’émotion posttraumatique se manifeste. Je frotte mon avant-bras sur mon front suintant, expire à plusieurs reprises pour rejeter la tension. J’hésite à repartir avec mon vélo chahuté mais intact. Ne pas reprendre du service me couperait les ailes pour de bon. Je rembobine le film, le stocke dans ma mémoire et refoule le drame qui aurait pu se produire. Je serre les poings, rentre le ventre et cligne des yeux. La frayeur s’efface. Mon filet mignon de Pata Negra attendra. Clopin-clopant, je repars, dodeline des épaules, trotte comme si de rien n’était et m’aventure vers les zigzags qui strient le bord de mer. »
(p. 230-235)
Nelson et Marta (p. 52-56)
Une histoire mouvementée (p. 130-135)
Extrait court


