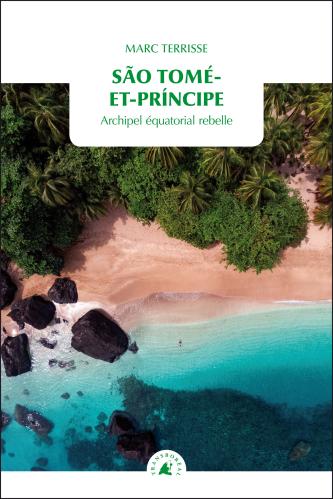
Une histoire mouvementée :
« Nous débutons notre pèlerinage culturel par la chapelle São Sebastião. Ici, point de saint harnaché à une colonne corinthienne en ruine faisant office de pilori, point de martyr transpercé d’une myriade de flèches comme observé sur le tableau d’Andrea Mantegna intitulé proprement Saint-Sébastien et accroché dans la Grande Galerie du musée du Louvre au milieu d’autres chefs-d’œuvre. C’est saint Georges qui tient la vedette. Le patron des marins veille sur les innombrables pêcheurs et navigateurs que comptent la ville et l’île depuis sa statue nichée sur la porte d’entrée du lieu saint. À l’intérieur, un baroque incertain, aux dorures dépourvues d’outrecuidance, un style assez éloigné des standards portugais où l’on hésite entre minimalisme et extravagance, déchirement stylistique qui me plaît, car c’est tout de même une impression de simplicité qui l’emporte.
Le directeur du musée profite de mon observation attentive des multiples ex-voto déposés entre les murs – coquillages, maquettes de bateau mal bricolées, oriflammes mitées et autres objets rappelant la mer – pour commenter les motivations qui ont valu à l’institution de naître en 1976. L’indépendance nouvellement acquise en 1975 avait besoin de fédérer les différentes communautés éparses qui composent la société de São Tomé-et-Príncipe. Il fallait aussi modifier le regard sur l’histoire de l’archipel, tenter de se l’approprier, de la réécrire tant le regard colonial pesait et minimisait bien des épisodes douloureux comme l’esclavage et la traite.
J’opine, façon d’exprimer ma solidarité. Ce discours me rappelle le roman Musée national de la Libanaise Diane Mazloum. Sa langue satinée recolle les morceaux d’une identité fracturée par les affrontements fratricides qu’a connus le pays du Cèdre. Le musée, objet éminemment politique comme j’ai pu le constater tout au long de ma carrière, peut recoudre les plaies, faire office de point de suture, dès lors qu’il concilie tous les regards sur des mémoires éclatées. Il peut aussi servir les mythes les plus fous et flatter des totalitarismes abjects.
J’emboîte le pas du directeur dans les salles suivantes. Des illustrations font référence à la culture de la canne, aux plantations et aux conditions de vie terribles de ceux qui y étaient exploités. Je me sens immergé dans ce quotidien funeste, ressens les humiliations, la bestialité des maîtres. Mon cou trémule, spasme provoqué par la vilenie, haine envers les assassins. Des fresques contemporaines parlent d’Amador Vieira et de son combat pour la liberté. L’hagiographie est en marche, justifiée par la nécessité de s’identifier, de créer des héros, un panthéon national, un miroir dans lequel le peuple peut se regarder avec fierté. C’est de bonne guerre, et São Tomé-et-Príncipe en a bien besoin. Le musée se fait tremplin identitaire, mais attention aux sagas trop belles pour prospérer ad vitam æternam ! Les fables sont friables.
Je remballe mes doutes quand nous abordons les périodes relatives à l’introduction du café et du cacao. Je contemple une salle à manger au service en porcelaine impeccable, reconstitution d’un intérieur de maison de maître des fameuses roças qui prospèrent tout au long du xixe siècle sur l’île. Je découvre des meubles indo-européens, très en vogue à l’époque coloniale chez ceux qui tiraient profit du commerce. Une chambre de maître est exposée avec minutie ainsi que divers objets usuels. Tout cela vous inciterait à partager le quotidien de cette famille si l’origine de ce confort ne reposait pas sur l’exploitation des plus faibles. Cette opulence me laisse un goût amer, l’envie de rendre, de crier à l’imposture.
“Maintes anecdotes dont je ne vous ai pas parlé me viennent à l’esprit au sujet de Príncipe. Puisque l’on parle de cacao, je ne peux ignorer le personnage de Maria Correia. Si un jour vous allez dans le nord-ouest de Príncipe pour voir la chapelle de Ribeira Izé, sans doute la première construite sur l’île et qui menace malheureusement de s’effondrer, n’oubliez pas ce que je vais vous raconter. Maria Correia (1788-1861) avait obtenu par mariage la propriété des terres des alentours et y aurait fait ériger une église à la mort de son premier conjoint. On surnomme Maria la princesse noire et on lui prête des pouvoirs magiques ainsi qu’un caractère volage, du fait de ses nombreux amants et époux qu’elle aurait fait disparaître selon les racontars. Maria a convolé en justes noces à plusieurs reprises, n’a jamais eu de descendance et a hérité de deux roças. Femme puissante, entreprenante, autoritaire, mécène, autonome, éprise de liberté et en avance sur son temps, elle est considérée comme une sorcière par ses détracteurs jaloux. On ne sait où ses restes reposent mais la tradition veut que son âme hante l’église de Ribeira Izé où des rituels sont organisés pour invoquer son esprit la nuit venue.”
L’esclavage est aboli en 1876, remplacé aussitôt par le travail forcé des populations déportées du Cap-Vert, de l’Angola et du Mozambique. La présence de cette nouvelle main-d’œuvre asservie est évoquée à travers les outils que ces derniers utilisaient pour cultiver les champs, doux euphémisme. Les sacrifices d’Amador n’auront donc servi à rien ! Mon indignation est allégée par le parcours du livre à ciel ouvert soudain plus grave. L’émotion est à son comble. Une lumière tamisée recouvre une série de portraits. Ma gorge se serre. Une ambiance lourde se dégage. Cela évoque la mort, le deuil, l’horreur. “Nous sommes le 3 février 1953”, déclame d’une voix chevrotante le directeur de l’établissement. Il me raconte toujours avec ce même ton pesant qu’autour de cette date des descendants d’esclaves affranchis manifestent. Ils refusent de se plier aux injonctions des maîtres des roças qui leur rappellent le temps d’avant, celui où seule la loi du fouet régnait, celui où le droit de désobéir était impensable. Les propriétaires des plantations de café et de cacao ont pourtant besoin de main-d’œuvre, ils ont bien fait venir des contractuels, les serviçais, des autres colonies africaines lusophones, mais cela ne suffit pas. Les manifestants mettent en péril l’ordre social, enraient la machine économique et leurs idéaux aux accents communistes risquent de contaminer l’ensemble des travailleurs de l’archipel. Dans le village de Batepá situé tout près de Trindade où a lieu le défilé des cortèges de mécontents, les représentants du colonisateur portugais ouvrent le feu sur la foule.
Des centaines voire des milliers d’innocents sont massacrés. Certains sont arrêtés, torturés, exécutés dans les prisons ; d’autres périssent dans des incendies provoqués par les autorités. Des serviçais, manipulés par le pouvoir en place mais craignant également de voir leurs emplois disparaître, participent aux exactions. Diviser pour mieux régner, telle pourrait être la devise de ce colonialisme responsable des crimes les plus odieux. La terrible répression va servir de carburant aux partisans de l’indépendance. Cette triste journée est entrée dans le calendrier santoméen puisqu’elle est célébrée chaque 3 février. Cette histoire a laissé des stigmates. Les serviçais ont longtemps été pointés du doigt, le droit de vote n’est ainsi pas octroyé aux Cap-Verdiens après l’indépendance.
Mon sternum s’alourdit, un étau comprime ma cage thoracique, des images tournicotent. Je ralentis ma progression, fléchis mon genou gauche et pose la main sur ma poitrine. “Vous voulez un verre d’eau ? Vous êtes livide, ça n’a pas l’air d’aller.” Je déglutis, remercie le conservateur pour sa proposition que je décline et affronte les visages des innocents gravés dans cet espace digne d’une chapelle ardente. L’émotion ne me quitte plus. Des documents historiques sont conservés dans les vitrines et les présentoirs pour ne rien oublier. “Il faut aller à Fernão Dias, dans le nord-est du pays. Là-bas, vous trouverez un mémorial très émouvant à l’emplacement d’un ancien camp de travail forcé.”
Une pléiade de portraits de présidents portugais venus sur l’île, dont Mário Soares, m’accueille dans une pièce aux parois brunâtres mal aplanies. L’orage est passé. Mon état s’améliore, un souffle ardent s’infiltre sous mes vêtements, mon visage s’empourpre. Puis ce sont d’autres portraits, ceux des princes du cacao, qui cadencent les ultimes pièces du musée comme le faisaient jadis les tableaux des souverains de l’Ancien Régime ou les représentations marbrées des empereurs romains. Cette galerie de personnages illustres, très masculine, n’est que caricature. Les gros nez, les moustaches aussi épaisses que les sourcils, les barbes trop fines, les favoris virent au grotesque tout en défendant une certaine idée du snobisme. Ces précieux ridicules ne m’inspirent aucune sympathie. »
Nelson et Marta (p. 52-56)
Sur la route de Santa Catarina (p. 230-235)
Extrait court
« Nous débutons notre pèlerinage culturel par la chapelle São Sebastião. Ici, point de saint harnaché à une colonne corinthienne en ruine faisant office de pilori, point de martyr transpercé d’une myriade de flèches comme observé sur le tableau d’Andrea Mantegna intitulé proprement Saint-Sébastien et accroché dans la Grande Galerie du musée du Louvre au milieu d’autres chefs-d’œuvre. C’est saint Georges qui tient la vedette. Le patron des marins veille sur les innombrables pêcheurs et navigateurs que comptent la ville et l’île depuis sa statue nichée sur la porte d’entrée du lieu saint. À l’intérieur, un baroque incertain, aux dorures dépourvues d’outrecuidance, un style assez éloigné des standards portugais où l’on hésite entre minimalisme et extravagance, déchirement stylistique qui me plaît, car c’est tout de même une impression de simplicité qui l’emporte.
Le directeur du musée profite de mon observation attentive des multiples ex-voto déposés entre les murs – coquillages, maquettes de bateau mal bricolées, oriflammes mitées et autres objets rappelant la mer – pour commenter les motivations qui ont valu à l’institution de naître en 1976. L’indépendance nouvellement acquise en 1975 avait besoin de fédérer les différentes communautés éparses qui composent la société de São Tomé-et-Príncipe. Il fallait aussi modifier le regard sur l’histoire de l’archipel, tenter de se l’approprier, de la réécrire tant le regard colonial pesait et minimisait bien des épisodes douloureux comme l’esclavage et la traite.
J’opine, façon d’exprimer ma solidarité. Ce discours me rappelle le roman Musée national de la Libanaise Diane Mazloum. Sa langue satinée recolle les morceaux d’une identité fracturée par les affrontements fratricides qu’a connus le pays du Cèdre. Le musée, objet éminemment politique comme j’ai pu le constater tout au long de ma carrière, peut recoudre les plaies, faire office de point de suture, dès lors qu’il concilie tous les regards sur des mémoires éclatées. Il peut aussi servir les mythes les plus fous et flatter des totalitarismes abjects.
J’emboîte le pas du directeur dans les salles suivantes. Des illustrations font référence à la culture de la canne, aux plantations et aux conditions de vie terribles de ceux qui y étaient exploités. Je me sens immergé dans ce quotidien funeste, ressens les humiliations, la bestialité des maîtres. Mon cou trémule, spasme provoqué par la vilenie, haine envers les assassins. Des fresques contemporaines parlent d’Amador Vieira et de son combat pour la liberté. L’hagiographie est en marche, justifiée par la nécessité de s’identifier, de créer des héros, un panthéon national, un miroir dans lequel le peuple peut se regarder avec fierté. C’est de bonne guerre, et São Tomé-et-Príncipe en a bien besoin. Le musée se fait tremplin identitaire, mais attention aux sagas trop belles pour prospérer ad vitam æternam ! Les fables sont friables.
Je remballe mes doutes quand nous abordons les périodes relatives à l’introduction du café et du cacao. Je contemple une salle à manger au service en porcelaine impeccable, reconstitution d’un intérieur de maison de maître des fameuses roças qui prospèrent tout au long du xixe siècle sur l’île. Je découvre des meubles indo-européens, très en vogue à l’époque coloniale chez ceux qui tiraient profit du commerce. Une chambre de maître est exposée avec minutie ainsi que divers objets usuels. Tout cela vous inciterait à partager le quotidien de cette famille si l’origine de ce confort ne reposait pas sur l’exploitation des plus faibles. Cette opulence me laisse un goût amer, l’envie de rendre, de crier à l’imposture.
“Maintes anecdotes dont je ne vous ai pas parlé me viennent à l’esprit au sujet de Príncipe. Puisque l’on parle de cacao, je ne peux ignorer le personnage de Maria Correia. Si un jour vous allez dans le nord-ouest de Príncipe pour voir la chapelle de Ribeira Izé, sans doute la première construite sur l’île et qui menace malheureusement de s’effondrer, n’oubliez pas ce que je vais vous raconter. Maria Correia (1788-1861) avait obtenu par mariage la propriété des terres des alentours et y aurait fait ériger une église à la mort de son premier conjoint. On surnomme Maria la princesse noire et on lui prête des pouvoirs magiques ainsi qu’un caractère volage, du fait de ses nombreux amants et époux qu’elle aurait fait disparaître selon les racontars. Maria a convolé en justes noces à plusieurs reprises, n’a jamais eu de descendance et a hérité de deux roças. Femme puissante, entreprenante, autoritaire, mécène, autonome, éprise de liberté et en avance sur son temps, elle est considérée comme une sorcière par ses détracteurs jaloux. On ne sait où ses restes reposent mais la tradition veut que son âme hante l’église de Ribeira Izé où des rituels sont organisés pour invoquer son esprit la nuit venue.”
L’esclavage est aboli en 1876, remplacé aussitôt par le travail forcé des populations déportées du Cap-Vert, de l’Angola et du Mozambique. La présence de cette nouvelle main-d’œuvre asservie est évoquée à travers les outils que ces derniers utilisaient pour cultiver les champs, doux euphémisme. Les sacrifices d’Amador n’auront donc servi à rien ! Mon indignation est allégée par le parcours du livre à ciel ouvert soudain plus grave. L’émotion est à son comble. Une lumière tamisée recouvre une série de portraits. Ma gorge se serre. Une ambiance lourde se dégage. Cela évoque la mort, le deuil, l’horreur. “Nous sommes le 3 février 1953”, déclame d’une voix chevrotante le directeur de l’établissement. Il me raconte toujours avec ce même ton pesant qu’autour de cette date des descendants d’esclaves affranchis manifestent. Ils refusent de se plier aux injonctions des maîtres des roças qui leur rappellent le temps d’avant, celui où seule la loi du fouet régnait, celui où le droit de désobéir était impensable. Les propriétaires des plantations de café et de cacao ont pourtant besoin de main-d’œuvre, ils ont bien fait venir des contractuels, les serviçais, des autres colonies africaines lusophones, mais cela ne suffit pas. Les manifestants mettent en péril l’ordre social, enraient la machine économique et leurs idéaux aux accents communistes risquent de contaminer l’ensemble des travailleurs de l’archipel. Dans le village de Batepá situé tout près de Trindade où a lieu le défilé des cortèges de mécontents, les représentants du colonisateur portugais ouvrent le feu sur la foule.
Des centaines voire des milliers d’innocents sont massacrés. Certains sont arrêtés, torturés, exécutés dans les prisons ; d’autres périssent dans des incendies provoqués par les autorités. Des serviçais, manipulés par le pouvoir en place mais craignant également de voir leurs emplois disparaître, participent aux exactions. Diviser pour mieux régner, telle pourrait être la devise de ce colonialisme responsable des crimes les plus odieux. La terrible répression va servir de carburant aux partisans de l’indépendance. Cette triste journée est entrée dans le calendrier santoméen puisqu’elle est célébrée chaque 3 février. Cette histoire a laissé des stigmates. Les serviçais ont longtemps été pointés du doigt, le droit de vote n’est ainsi pas octroyé aux Cap-Verdiens après l’indépendance.
Mon sternum s’alourdit, un étau comprime ma cage thoracique, des images tournicotent. Je ralentis ma progression, fléchis mon genou gauche et pose la main sur ma poitrine. “Vous voulez un verre d’eau ? Vous êtes livide, ça n’a pas l’air d’aller.” Je déglutis, remercie le conservateur pour sa proposition que je décline et affronte les visages des innocents gravés dans cet espace digne d’une chapelle ardente. L’émotion ne me quitte plus. Des documents historiques sont conservés dans les vitrines et les présentoirs pour ne rien oublier. “Il faut aller à Fernão Dias, dans le nord-est du pays. Là-bas, vous trouverez un mémorial très émouvant à l’emplacement d’un ancien camp de travail forcé.”
Une pléiade de portraits de présidents portugais venus sur l’île, dont Mário Soares, m’accueille dans une pièce aux parois brunâtres mal aplanies. L’orage est passé. Mon état s’améliore, un souffle ardent s’infiltre sous mes vêtements, mon visage s’empourpre. Puis ce sont d’autres portraits, ceux des princes du cacao, qui cadencent les ultimes pièces du musée comme le faisaient jadis les tableaux des souverains de l’Ancien Régime ou les représentations marbrées des empereurs romains. Cette galerie de personnages illustres, très masculine, n’est que caricature. Les gros nez, les moustaches aussi épaisses que les sourcils, les barbes trop fines, les favoris virent au grotesque tout en défendant une certaine idée du snobisme. Ces précieux ridicules ne m’inspirent aucune sympathie. »
(p. 130-135)
Nelson et Marta (p. 52-56)
Sur la route de Santa Catarina (p. 230-235)
Extrait court


