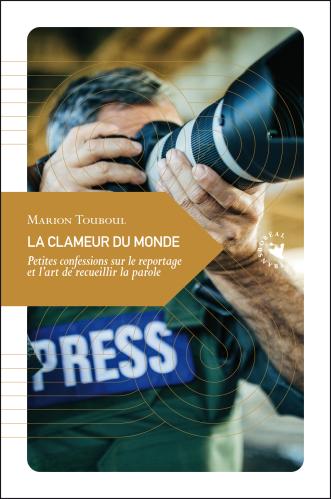
Seul à seul :
« Je ne connais pas de métier plus solitaire : le reporter est seul face à son ordinateur pour écrire sa proposition, seul lors des repérages, seul le soir dans la chambre d’hôtel après sa journée de terrain. Et quand vient l’étape du montage, c’est seul qu’il se retire pour restituer ce qu’il a vécu. Que sa production finale soit écrite, radiophonique ou audiovisuelle, il va devoir passer des journées derrière un écran d’ordinateur, parfois dans un studio obscur et coupé du monde par ses parois insonorisées. Quand il a de la chance, un monteur vient à sa rescousse. Quel bonheur de pouvoir alors construire, agencer les sons, les images et les témoignages, traduire, chercher le fil pour raconter l’histoire, synthétiser, donner du souffle, du rythme ! Pourtant, je vis parfois mal cette étape du travail. Un jour me vient une idée : partir à Istanbul et monter mes reportages dans un café tranquille face à l’ancienne basilique Sainte-Sophie, devant un thé et une pâtisserie orientale. Les premiers jours sont réjouissants mais, rapidement, je me sens déphasée, aspirée par les sons que j’agence et déconnectée des gens qui m’entourent. Je passe mes après-midi à errer l’esprit ankylosé et, quand vient le soir, je troque ma chambre d’hôtel pour un lit dans un dortoir bondé, car j’ai besoin du ronflement des autres pour apaiser ma solitude. J’avais l’impression d’être un disque saturé. Quelque chose en moi était en train de céder. Qu’allais-je devenir ? Parcourir le monde quand on a 30 ans passe encore, mais que dire lorsque l’élan perdure à l’aune de la quarantaine ? Ce métier, les circonstances dans lesquelles le reporter est contraint de l’exercer – solitude et précarité – n’était-il pas finalement un repli plutôt qu’une ouverture au monde ? “Cette question du temps est importante quand on est reporter”, assure Florence Aubenas dans Grand reporter : petite conférence sur le journalisme. “J’ai souvent l’impression que c’est un métier où les gens ne vieillissent pas très bien. On pourrait penser qu’une vie pleine d’aventures permet de s’endurcir, que l’expérience rend le cuir plus épais et que l’intimité avec le danger aguerrit l’âme et les nerfs. Je crois que c’est l’inverse. On devient de plus en plus fragile, sensible.” J’en eus la confirmation le lendemain. Il faisait froid et pluvieux. Je suis partie en quête de chaleur dans un hammam où une dame turque de l’âge de ma mère m’a reçue. Elle était belle et, dans un silence aquatique, m’a souri. Je ne pouvais quitter des yeux la marque d’une césarienne qui traversait son ventre. “J’ai six enfants”, me confia-t-elle. Je me sentis vide à ses côtés. Étais-je en train de passer à côté de l’essentiel ? Je voyais de moins en moins mes amis, ma vie sentimentale était au point mort. Voyager est une guerre perdue, pensais-je alors. Et ma liberté une vis sans fin, qui au lieu d’enivrer, emprisonne.
Le journaliste, témoin du monde, n’échappe pas aux contradictions. La plus flagrante est incontestablement ses déplacements incessants (insensés ?) à travers le monde. L’Amazonie en feu, la forêt de Bornéo qu’on rase, les pôles qui fondent, Madagascar soumis à des cyclones de plus en plus violents, le Bangladesh sous les eaux? À mesure que les drames environnementaux se succèdent, il enchaîne les vols long-courriers. Quelle est sa part de responsabilité ? La même que celle d’un citoyen qui n’a jamais mis les pieds dans un A380 ? Ou est-elle amoindrie par le fait qu’il compense en informant ?
L’écologie a d’abord été cantonnée à des rubriques dédiées, mais la multiplication des catastrophes a contraint les médias à s’adapter. De BFM au Figaro, les questions environnementales irriguent désormais le contenu des fils d’information. Déforestation, sécheresse, réfugiés climatiques, agriculture intensive? Voilà le reporter investi d’un rôle nouveau et historique : raconter l’extinction possible de son espèce. Mais faut-il nécessairement partir pour dénoncer ? Comment combiner journalisme et réchauffement planétaire ? Prenons l’exemple de l’Amazonie. Des journalistes colombiens, péruviens, brésiliens témoignent quotidiennement du saccage de leur écosystème. Ils enquêtent, filment, interrogent avec souvent des accès bien plus étoffés que ceux d’un journaliste occidental puisqu’ils font partie du monde qu’ils documentent. Or, la plupart du temps, nous nous déplaçons et ils deviennent nos fixeurs. Mesurons l’aberration : l’envoyé spécial contribue par son empreinte carbone à fragiliser la planète dont il dénoncera la destruction via un journaliste local qui aurait très bien pu le faire ! Ne serait-il pas judicieux d’utiliser Internet à bon escient afin de réduire les déplacements et gagner en cohérence dans les fondements même d’un reportage ? Il ne s’agirait pas de prendre pour argent comptant la production d’un reporter étranger mais bien de collaborer avec lui, à distance. Nous en sommes loin. En 2022, le label Ecoprod Pionnier est créé afin de prendre en compte les questions environnementales d’une production télévisée. Pour être estampillé, un documentaire doit répondre à vingt-cinq critères, comme le nombre de vols empruntés, l’utilisation de produits plastiques lors du tournage? Pour l’heure, sur les dizaines de films produits chaque année par les chaînes de télévision, seuls douze ont été récompensés. Les raisons d’espérer existent pourtant. La même année, une charte “pour un journalisme à la hauteur de l’urgence climatique” est signée par plus de 1 000 journalistes français représentant des dizaines de journaux, des chaînes de radio et de télé. »
Révolution (p. 11-15)
La conscience journalistique (p. 37-40)
Extrait court
« Je ne connais pas de métier plus solitaire : le reporter est seul face à son ordinateur pour écrire sa proposition, seul lors des repérages, seul le soir dans la chambre d’hôtel après sa journée de terrain. Et quand vient l’étape du montage, c’est seul qu’il se retire pour restituer ce qu’il a vécu. Que sa production finale soit écrite, radiophonique ou audiovisuelle, il va devoir passer des journées derrière un écran d’ordinateur, parfois dans un studio obscur et coupé du monde par ses parois insonorisées. Quand il a de la chance, un monteur vient à sa rescousse. Quel bonheur de pouvoir alors construire, agencer les sons, les images et les témoignages, traduire, chercher le fil pour raconter l’histoire, synthétiser, donner du souffle, du rythme ! Pourtant, je vis parfois mal cette étape du travail. Un jour me vient une idée : partir à Istanbul et monter mes reportages dans un café tranquille face à l’ancienne basilique Sainte-Sophie, devant un thé et une pâtisserie orientale. Les premiers jours sont réjouissants mais, rapidement, je me sens déphasée, aspirée par les sons que j’agence et déconnectée des gens qui m’entourent. Je passe mes après-midi à errer l’esprit ankylosé et, quand vient le soir, je troque ma chambre d’hôtel pour un lit dans un dortoir bondé, car j’ai besoin du ronflement des autres pour apaiser ma solitude. J’avais l’impression d’être un disque saturé. Quelque chose en moi était en train de céder. Qu’allais-je devenir ? Parcourir le monde quand on a 30 ans passe encore, mais que dire lorsque l’élan perdure à l’aune de la quarantaine ? Ce métier, les circonstances dans lesquelles le reporter est contraint de l’exercer – solitude et précarité – n’était-il pas finalement un repli plutôt qu’une ouverture au monde ? “Cette question du temps est importante quand on est reporter”, assure Florence Aubenas dans Grand reporter : petite conférence sur le journalisme. “J’ai souvent l’impression que c’est un métier où les gens ne vieillissent pas très bien. On pourrait penser qu’une vie pleine d’aventures permet de s’endurcir, que l’expérience rend le cuir plus épais et que l’intimité avec le danger aguerrit l’âme et les nerfs. Je crois que c’est l’inverse. On devient de plus en plus fragile, sensible.” J’en eus la confirmation le lendemain. Il faisait froid et pluvieux. Je suis partie en quête de chaleur dans un hammam où une dame turque de l’âge de ma mère m’a reçue. Elle était belle et, dans un silence aquatique, m’a souri. Je ne pouvais quitter des yeux la marque d’une césarienne qui traversait son ventre. “J’ai six enfants”, me confia-t-elle. Je me sentis vide à ses côtés. Étais-je en train de passer à côté de l’essentiel ? Je voyais de moins en moins mes amis, ma vie sentimentale était au point mort. Voyager est une guerre perdue, pensais-je alors. Et ma liberté une vis sans fin, qui au lieu d’enivrer, emprisonne.
Le journaliste, témoin du monde, n’échappe pas aux contradictions. La plus flagrante est incontestablement ses déplacements incessants (insensés ?) à travers le monde. L’Amazonie en feu, la forêt de Bornéo qu’on rase, les pôles qui fondent, Madagascar soumis à des cyclones de plus en plus violents, le Bangladesh sous les eaux? À mesure que les drames environnementaux se succèdent, il enchaîne les vols long-courriers. Quelle est sa part de responsabilité ? La même que celle d’un citoyen qui n’a jamais mis les pieds dans un A380 ? Ou est-elle amoindrie par le fait qu’il compense en informant ?
L’écologie a d’abord été cantonnée à des rubriques dédiées, mais la multiplication des catastrophes a contraint les médias à s’adapter. De BFM au Figaro, les questions environnementales irriguent désormais le contenu des fils d’information. Déforestation, sécheresse, réfugiés climatiques, agriculture intensive? Voilà le reporter investi d’un rôle nouveau et historique : raconter l’extinction possible de son espèce. Mais faut-il nécessairement partir pour dénoncer ? Comment combiner journalisme et réchauffement planétaire ? Prenons l’exemple de l’Amazonie. Des journalistes colombiens, péruviens, brésiliens témoignent quotidiennement du saccage de leur écosystème. Ils enquêtent, filment, interrogent avec souvent des accès bien plus étoffés que ceux d’un journaliste occidental puisqu’ils font partie du monde qu’ils documentent. Or, la plupart du temps, nous nous déplaçons et ils deviennent nos fixeurs. Mesurons l’aberration : l’envoyé spécial contribue par son empreinte carbone à fragiliser la planète dont il dénoncera la destruction via un journaliste local qui aurait très bien pu le faire ! Ne serait-il pas judicieux d’utiliser Internet à bon escient afin de réduire les déplacements et gagner en cohérence dans les fondements même d’un reportage ? Il ne s’agirait pas de prendre pour argent comptant la production d’un reporter étranger mais bien de collaborer avec lui, à distance. Nous en sommes loin. En 2022, le label Ecoprod Pionnier est créé afin de prendre en compte les questions environnementales d’une production télévisée. Pour être estampillé, un documentaire doit répondre à vingt-cinq critères, comme le nombre de vols empruntés, l’utilisation de produits plastiques lors du tournage? Pour l’heure, sur les dizaines de films produits chaque année par les chaînes de télévision, seuls douze ont été récompensés. Les raisons d’espérer existent pourtant. La même année, une charte “pour un journalisme à la hauteur de l’urgence climatique” est signée par plus de 1 000 journalistes français représentant des dizaines de journaux, des chaînes de radio et de télé. »
(p. 68-72)
Révolution (p. 11-15)
La conscience journalistique (p. 37-40)
Extrait court


