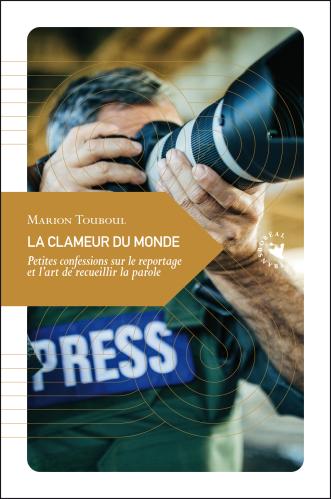
La conscience journalistique :
« Subjectivité ? Je perçois une légère mais bien réelle déception dans le regard de mon entourage quand je prononce ce mot. Subjective, je le suis assurément ! Seule une intelligence artificielle pourrait raconter le monde à la manière d’un arbitre (et encore, il arrive que certaines informations soient volontairement gommées par le pouvoir en place). Par définition, l’objectivité est la qualité de quelqu’un, d’un esprit, d’un groupe qui porte un jugement sans faire intervenir de préférences personnelles. L’idée est belle mais utopique. On s’empresse d’ailleurs de la déconstruire dans les écoles de journalisme. Prenons l’exemple d’une manifestation. Deux photographes n’en rapporteront jamais les mêmes clichés puisque l’un aura choisi de se poster sur un toit et l’autre à proximité des CRS. Pour avoir une vision globale d’une situation, la solution serait donc d’acheter différents journaux. Mais qu’en est-il lorsque je suis sur le terrain, lorsque sur place deux clans s’opposent et s’ignorent ? Comment passer de l’un à l’autre ? Dois-je à tout prix chercher à donner à voir la vision la plus large possible ? Cette question me travaille lorsque, en 2021, je vais au Mexique, dans l’isthme de Tehuantepec, pour raconter le foisonnement d’éoliennes françaises sous le regard de paysans dépossédés de leurs champs. Je veux raconter le quotidien de ces habitants confrontés au béton mais aussi la frénésie verte d’EDF convaincue d’œuvrer pour notre bien-être en produisant une énergie prétendument “propre”. Or ces mondes ne se côtoient pas. J’obtiens finalement l’accord de l’entreprise pour suivre les équipes sur place. Voilà mon carnet rempli de témoignages diamétralement opposés : le point de vue de ceux qui vivent sous les éoliennes et de ceux qui les construisent. À l’écrit, je tâcherai de les entremêler. Mais suis-je pour autant objective ? “Je n’ai jamais dit que j’étais un journaliste objectif parce que je ne le suis pas, parce que personne n’est objectif. Ceux qui prétendent l’être sont faux et hypocrites”, confie Tiziano Terzani dans Le Grand Voyage de la vie, Un père raconte à son fils. Effectivement, si je m’intéresse à cette histoire, c’est que la révolte des paysans zapotèques contre le capitalisme vert me parle. Leur destin m’interpelle. J’ai grandi à la campagne : je sais la difficulté du travail de la terre. Si mes parents avaient travaillé chez EDF, mon reportage en aurait peut-être été différent. Un journaliste n’écrit donc pas à partir d’une page blanche mais à partir de son enfance, de ses peurs, de ses désirs et de ses fantasmes. D’un même événement découlent plusieurs visions, comme les multiples facettes d’un diamant. Le reporter fera toujours le choix conscient ou inconscient d’éclairer une facette plutôt qu’une autre.
À la subjectivité de l’auteur vient s’ajouter la ligne politique des grands médias, privés pour la plupart. En 2025, neuf milliardaires possèdent 90 % des journaux, magazines, chaînes de radio et de télévision français. Serge Dassault, Patrick Drahi, Vincent Bolloré? Ces hommes d’affaires ont injecté à partir des années 2010 l’argent nécessaire pour compenser l’effondrement des revenus publicitaires. Chaque titre suit une ligne éditoriale qui lui est propre : de droite pour Le Figaro, de gauche pour L’Humanité, de centre-gauche pour Le Monde. L’information est devenue un bien de consommation comme un autre? et un enjeu de pouvoir. CNews, Europe 1, Paris Match, Le Journal du dimanche? Ces médias ont depuis 2017 connus le même sort : rachetés par Vincent Bolloré, leur ligne flirte désormais avec l’extrême-droite. En témoigne la nomination de Geoffroy Lejeune, ancien patron du magazine Valeurs actuelles, à la tête du Journal du dimanche. Les journalistes se révoltent, entrent en grève mais sont priés à chaque fois de se plier aux règles ou de quitter le navire. C’est ce qu’ont fait la quasi-totalité des journalistes du JDD. »
Révolution (p. 11-15)
Seul à seul (p. 68-72)
Extrait court
« Subjectivité ? Je perçois une légère mais bien réelle déception dans le regard de mon entourage quand je prononce ce mot. Subjective, je le suis assurément ! Seule une intelligence artificielle pourrait raconter le monde à la manière d’un arbitre (et encore, il arrive que certaines informations soient volontairement gommées par le pouvoir en place). Par définition, l’objectivité est la qualité de quelqu’un, d’un esprit, d’un groupe qui porte un jugement sans faire intervenir de préférences personnelles. L’idée est belle mais utopique. On s’empresse d’ailleurs de la déconstruire dans les écoles de journalisme. Prenons l’exemple d’une manifestation. Deux photographes n’en rapporteront jamais les mêmes clichés puisque l’un aura choisi de se poster sur un toit et l’autre à proximité des CRS. Pour avoir une vision globale d’une situation, la solution serait donc d’acheter différents journaux. Mais qu’en est-il lorsque je suis sur le terrain, lorsque sur place deux clans s’opposent et s’ignorent ? Comment passer de l’un à l’autre ? Dois-je à tout prix chercher à donner à voir la vision la plus large possible ? Cette question me travaille lorsque, en 2021, je vais au Mexique, dans l’isthme de Tehuantepec, pour raconter le foisonnement d’éoliennes françaises sous le regard de paysans dépossédés de leurs champs. Je veux raconter le quotidien de ces habitants confrontés au béton mais aussi la frénésie verte d’EDF convaincue d’œuvrer pour notre bien-être en produisant une énergie prétendument “propre”. Or ces mondes ne se côtoient pas. J’obtiens finalement l’accord de l’entreprise pour suivre les équipes sur place. Voilà mon carnet rempli de témoignages diamétralement opposés : le point de vue de ceux qui vivent sous les éoliennes et de ceux qui les construisent. À l’écrit, je tâcherai de les entremêler. Mais suis-je pour autant objective ? “Je n’ai jamais dit que j’étais un journaliste objectif parce que je ne le suis pas, parce que personne n’est objectif. Ceux qui prétendent l’être sont faux et hypocrites”, confie Tiziano Terzani dans Le Grand Voyage de la vie, Un père raconte à son fils. Effectivement, si je m’intéresse à cette histoire, c’est que la révolte des paysans zapotèques contre le capitalisme vert me parle. Leur destin m’interpelle. J’ai grandi à la campagne : je sais la difficulté du travail de la terre. Si mes parents avaient travaillé chez EDF, mon reportage en aurait peut-être été différent. Un journaliste n’écrit donc pas à partir d’une page blanche mais à partir de son enfance, de ses peurs, de ses désirs et de ses fantasmes. D’un même événement découlent plusieurs visions, comme les multiples facettes d’un diamant. Le reporter fera toujours le choix conscient ou inconscient d’éclairer une facette plutôt qu’une autre.
À la subjectivité de l’auteur vient s’ajouter la ligne politique des grands médias, privés pour la plupart. En 2025, neuf milliardaires possèdent 90 % des journaux, magazines, chaînes de radio et de télévision français. Serge Dassault, Patrick Drahi, Vincent Bolloré? Ces hommes d’affaires ont injecté à partir des années 2010 l’argent nécessaire pour compenser l’effondrement des revenus publicitaires. Chaque titre suit une ligne éditoriale qui lui est propre : de droite pour Le Figaro, de gauche pour L’Humanité, de centre-gauche pour Le Monde. L’information est devenue un bien de consommation comme un autre? et un enjeu de pouvoir. CNews, Europe 1, Paris Match, Le Journal du dimanche? Ces médias ont depuis 2017 connus le même sort : rachetés par Vincent Bolloré, leur ligne flirte désormais avec l’extrême-droite. En témoigne la nomination de Geoffroy Lejeune, ancien patron du magazine Valeurs actuelles, à la tête du Journal du dimanche. Les journalistes se révoltent, entrent en grève mais sont priés à chaque fois de se plier aux règles ou de quitter le navire. C’est ce qu’ont fait la quasi-totalité des journalistes du JDD. »
(p. 37-40)
Révolution (p. 11-15)
Seul à seul (p. 68-72)
Extrait court


