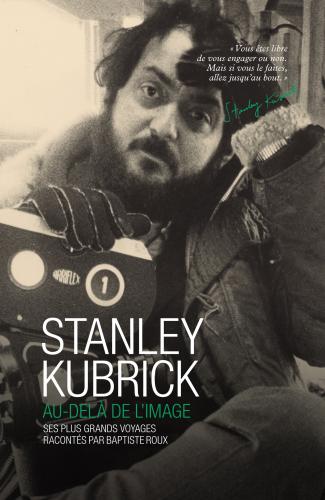
Introduction – L’Odyssée par la petite porte :
« Ma rencontre avec Kubrick aurait pu débuter sous de meilleurs auspices. Depuis des jours, la rumeur enflait au sein de notre groupe de lycéens cinéphiles des années 1980 : 2001, l’odyssée de l’espace allait être prochainement diffusé sur FR3 en début de soirée. L’adaptation par le génial réalisateur du non moins mythique roman d’Arthur C. Clarke allait nous faire franchir un seuil cinématographique aussi décisif que celui de la conversion stellaire du tibia, lancé crânement par l’un des hominidés à l’issue de la séquence The Dawn of Man.
Le soir tant espéré arriva enfin, et c’est avec ferveur que je découvris, ému, les premières images que l’antique et modeste récepteur familial (en noir et blanc) s’évertuait à retransmettre. Si la rixe des anthropoïdes me laissa pantois, la rotation hypnotique de l’hôtel Hilton puis les fastidieux échanges des scientifiques me plongèrent insensiblement dans une torpeur à peine entamée par les non moins soporifiques dialogues entre Bowman et HAL. Honteux de profaner par mon assoupissement un monument du septième art, je m’astreignis à fixer mon attention sur les déambulations des spationautes aux prises avec la duplicité de l’ordinateur.
Las ! leurs déambulations poussives, ponctuées d’expirations métronomiques, eurent bientôt raison de ma persévérance. J’avais quitté l’espace de la vigilance pour celui des songes? Les éruptions incantatoires des chœurs de Ligeti m’extirpèrent brutalement de ma léthargie. La confrontation de Bowman avec son double couché dans un lit de style Louis XV, au fin fond de l’univers, me plongea, elle, dans des abîmes de désarroi. Le lendemain matin, j’esquivai avec précaution toute la sémiologie du fœtus astral ou du monolithe pour m’éclipser en direction des salles de cours?
J’avais pourtant été saisi, entre deux clignements de paupières, par l’énigmatique envoûtement de cet objet filmique inclassable, dont le sens profond échappait à mon entendement. Quel voyage nous était-il donc conté ? Que fallait-il comprendre à cet opéra galactique, dont chaque image semblait produire une surabondance de sens philosophique ? Les trépignements simiesques ou les ballets astraux, j’en étais certain, constituaient les indices à partir desquels le cinéaste, chapitre après chapitre, devait écrire une nouvelle histoire de la connaissance dont il prophétisait l’avènement.
L’année suivante, la découverte tétanisée d’Orange mécanique en salle, dans une mauvaise copie, certes, mais du moins sur grand écran, puis celle des Sentiers de la gloire, pour sa première diffusion à la télévision, suscitèrent ma ferveur avivée par la lecture ébahie du maître ouvrage de Michel Ciment, dont l’acuité d’analyse permettait de mettre au jour des correspondances insoupçonnées entre les films et d’en révéler l’évidente unité. Puis, après des mois d’annonces et de reports, ce fut, en septembre 1987, la sidération de Full Metal Jacket – le premier Kubrick que je découvrais au moment de sa sortie sur les écrans. Il me fallut ensuite patienter douze interminables années pour pénétrer, le cœur fébrile, dans l’immense salle du Bretagne, à Montparnasse, où l’on projetait le chant du cygne, Eyes Wide Shut, par lequel je redoutais d’être déçu ; douze années pendant lesquelles j’avais visionné à l’envi tous les films du maître, consumé par le désir d’approcher l’œuvre interdite Fear and Desire.
On rapportait que le cinéaste en traquait chaque négatif pour le soustraire au public, désavouant cet essai grimaud et prétentieux. Invisible en France jusqu’à sa sortie officielle, en décembre 2012, l’opus liminaire de Kubrick faisait office de Saint-Graal pour les paladins du maître, objet d’une quête fébrile. Grâces soient rendues à mon ami Alexandre Gefen qui, au prix de trois nuits blanches, sonda les arcanes d’Internet afin de dénicher sur le site d’un obscur vidéoclub du Nebraska une version NSCP floue et cendrée ! Au prix de moult efforts oculaires, je parvins à y déceler les motifs en gésine, à savoir, la belligérance comme métaphore des conflits de puissance à l’intérieur d’un système, la désorganisation d’une structure et l’irrésistible emprise de la déraison.
Incidemment, Kubrick côtoya puis supplanta Hitchcock au sein de mon panthéon. Le foisonnement éditorial qui suivit sa mort parvint à peine à étancher ma soif d’informations sur la généalogie et l’exégèse de ses films mythiques. J’appris aussi à démystifier la légende du reclus paranoïaque vérifiant personnellement les copies de tous ses films, dont les émissaires patrouillaient les cinémas du monde entier pour contrôler chaque projecteur et intimer la réfection des salles, sous peine de mise au ban des circuits.
Aujourd’hui, l’œuvre de Kubrick représente pour moi non pas l’aboutissement du cinéma mais peut-être l’une de ses formes les plus accomplies. Si, schématiquement, les metteurs en scène se répartissent entre les formalistes et les analystes, le réalisateur de 2001, l’odyssée de l’espace parvient à conjoindre splendeur plastique et acuité du discours. Chaque film, par sa facture inédite, remet en jeu une nouvelle manière de concevoir l’art du récit par l’acte de naissance de caractères et de figures inoubliables. L’artiste refuse le confort d’un style préétabli et redéfinit, en amont, la manière et le langage cinématographiques exigés par l’histoire.
Éclectisme ne signifie en rien disparité. Film noir ou satire sociale, conte gothique ou péplum, les œuvres de Kubrick s’emparent des problématiques universelles que sont le refoulement des désirs, la quête de l’idéal, l’homme dans la guerre ou la hantise de la folie pour relater comment l’être ordinaire s’arrange de l’espace inconnu où il se trouve plongé. Cet apprivoisement suppose des choix qui ne sont jamais appréciés à l’aune de principes moraux mais selon ce que ces attitudes dévoilent de la part de violence ou de tragique propre à chacun. Moraliste sans dogme, Kubrick pratique un cinéma à hauteur d’homme, dont la cinglante lucidité a pu être interprétée comme une misanthropie ou un cynisme inavoués.
Du peloton symbolique égaré dans la guerre abstraite (Fear and Desire) aux méandres d’une psyché assaillie par la tentation du passage à l’acte (Eyes Wide Shut), le réalisateur aura construit son œuvre autour de l’aspiration humaine à se repositionner dans un univers propice à la désorientation. Alex (Orange mécanique), Docteur Folamour, Jack Torrance (The Shining) ou Bill Harford (Eyes Wide Shut) sont intimement persuadés qu’il existe une Vérité, un accès au sens caché du monde, si l’on parvient à lever les obstacles disposés tout au long du périple. Fort de cette conviction erronée, ils s’épuisent à reconstituer une identité morcelée, quand tout indique, souligne ironiquement Kubrick, qu’ils portent, par égarement ou orgueil, l’intégrale responsabilité de leurs désillusions.
Antipédagogique par excellence, le corpus des treize films édicte dans ses ambiguïtés et l’inconfort de ses postures la vanité de tout dogmatisme. L’être humain n’est jamais assignable à un caractère ou à une nature prédéterminés mais interagit avec les circonstances qui vont mettre en relief les aspects les plus contradictoires de sa personnalité. Le manichéisme, abhorré par l’artiste, génère une fracture indue au sein du monde qu’il découpe artificiellement. De fait, c’est justement cet espace interstitiel, où se défait la structure, que le cinéma de Kubrick choisit de radiographier, en partant du principe qu’il n’est de récit plus stupéfiant que celui de l’anatomie du désordre. Kubrick n’était pas, à cet égard, le dernier à revendiquer le droit à l’équivocité, lui que ses origines et sa culture judaïques n’ont jamais empêché de nourrir une trouble fascination pour le IIIe Reich ni d’épouser la nièce (la fille, selon John Baxter, l’un de ses biographes) de Veit Harlan, réalisateur officiel du régime nazi et du Juif Süss. Peut-être faut-il y voir une vitreuse fascination pour les agencements machiniques promis à la débâcle en raison de la fanatique négation du réel.
L’intelligence du créateur est de ne jamais asséner ses réflexions sur le confort de l’illusion, la nostalgie de l’absolu ou le désenchantement du monde. Marchant sur les brisées d’un Hitchcock, Kubrick aura su adosser l’exigence artistique à l’engouement populaire. Orange mécanique et Shining peuvent ainsi ravir un teenager du Midwest et un agrégé de l’Université tant sont plurivoques les niveaux de lecture. On s’enhardirait même à ajouter que le grand public s’est trouvé plus souvent en adéquation avec les intentions de l’artiste que la critique, parfois désemparée par les ruptures esthétiques ou l’absence de message explicite.
Un seul plan suffit pourtant à se convaincre d’un génie à l’œuvre. Le plus imperceptible cadre, la plus infime nuance de jeu ou la moindre note de musique relèvent de choix délibérés qui engagent éthiquement le cinéaste. Son perfectionnisme obsessionnel, présent à chaque étape de la conception, assorti de sa connaissance des différents postes – il assure, dès son premier opus, l’écriture du scénario, la photographie et le montage –, lui octroie la complète maîtrise d’un film dont il revendique la facture et assume la composition.
Auteur complet, le créateur de Barry Lyndon s’ingénie à conduire les possibilités offertes par son art dans leurs ultimes retranchements – il démontre aux ingénieurs de Zeiss, calculs de physique à l’appui, la possibilité théorique de façonner la courbure des lentilles afin de filmer à la seule lumière de candélabres, résolument convaincu de la nécessaire soumission de la technique aux commandements de l’art. L’expérience malheureuse de Spartacus, où il dut remplacer au pied levé Anthony Mann, congédié par Kirk Douglas, et multiplier les compromis humiliants, lui a enseigné l’intransigeance et le refus des concessions. Du choix de l’histoire au final cut, chaque étape du processus créatif est gouvernée par une semblable volonté de conformation à l’intérêt du récit. Nul effet, nulle vétille, ne doivent être négligés par cet homme capable de se perdre en spéculations au mixage sur la différence de texture sonore entre le bruit de pas sur une terre meuble et sur un sol détrempé – pour ses techniciens, il était phrase que le maestro ne prononcerait jamais : “Fais preuve d’initiative et ne m’ennuie pas avec les détails.” L’approximation ne saurait trouver place dans cette dynamique, qui ne connaît pas d’assistant subalterne. À cet égard, Kubrick confiait avoir rêvé dans sa jeunesse de devenir chef d’orchestre ; il ajouterait plus tard général. Contrairement aux idées reçues, le réalisateur était disposé à écouter toute suggestion susceptible de servir l’œuvre, qu’importât le rang hiérarchique du collaborateur improvisé. Le concierge du studio lui-même recevait un exemplaire du scénario au cas où, selon la formule consacrée, “il aurait une idée”.
L’identification de Kubrick à l’art cinématographique relève à ce point de l’évidence que l’on peine à imaginer la transposition de ses œuvres dans un autre média. Docteur Folamour, Shining et, bien entendu, 2001, l’odyssée de l’espace n’existent que par la fusion du mouvement, de la musique et de la parole au sein d’un même langage. Le cinéma marque l’apogée ou à tout le moins l’idéale conjonction de toutes les formes d’art, dont il épuise savamment les ressources. Sa démarche n’exclut donc pas une sorte de radicalité dans les choix (les stases contemplatives de 2001, l’odyssée de l’espace, l’abstraction graphique de Shining, le picturalisme de Docteur Folamour, etc.) qui réussissent l’exploit de situer en bonne place au box-office des films dont certaines séquences relèveraient plutôt de l’installation muséale ! L’œuvre kubrickienne n’est ni tributaire d’une idée ni asservie à une démonstration. Les interrogations ou conflits personnels qui sous-tendent l’histoire trouvent un écho immédiat chez le spectateur, qu’emportent les propositions visuelles et la polyphonie des situations. L’harmonie parfaite entre la dramaturgie et le rythme adopté représente le souci permanent d’un réalisateur pour lequel le montage fournit au cinéma son identité absolue – quand le scénario et l’interprétation, eux, ont déjà eu leurs prédécesseurs dans la littérature et le théâtre.
L’acte cinématographique est un apostolat, et Kubrick l’accomplit avec une gravité scrupuleuse. Le prix à payer est celui d’une piètre fécondité. L’homme qui déclarait, lors de la remise du prix D. W. Griffith pour l’ensemble de son œuvre, que “la réalisation d’un film s’apparentait à l’écriture de Guerre et paix à bord d’une autotamponneuse au milieu d’une fête foraine” était le premier navré du temps écoulé entre ses derniers films, mais il partait du principe que l’œuvre allait l’accompagner durant toute son existence, avec ses failles ou ses lacunes. Dans ces conditions, tout compromis aurait relevé de la renonciation voire de la faute morale ! Et c’est sans doute cette identification de l’homme à l’œuvre, cette collusion entre le créateur et son travail, qui expliquent le retrait de Kubrick à partir des années 1970, objet de conjectures infondées. La fréquentation du milieu du cinéma l’avait à ce point convaincu de son inanité qu’il se gardait de la compagnie des critiques ou des producteurs, recevant beaucoup plus volontiers dans son manoir de Childwickbury, outre des prix Nobel, plusieurs centaines d’invités à l’occasion de garden parties. Ce New-Yorkais avait fait de ses demeures d’Abbots Mead puis de Childwickbury des lieux stratégiques à partir desquels il pouvait organiser les tournages et procéder à la postproduction des films, sans délaisser la quiétude bucolique d’une vie dévolue à sa famille – l’autre passion de sa vie – et à ses six chiens et nombreux chats, dont il tenait à changer la litière personnellement sous le regard éberlué des visiteurs de passage.
Voyageur fort occasionnel puis farouchement sédentaire (les cinq jours de l’été 1961 qu’il consacre à l’arpentage des plages du Débarquement et des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, en compagnie de son épouse, sont les congés les plus longs qu’il se soit accordés), Kubrick met à profit les apports des nouvelles technologies (il se targuait de figurer parmi les premiers Britanniques à posséder un fax puis un traitement de texte) pour effectuer depuis son domicile toutes les tâches incombant à son activité ou entretenir ses relations sociales. Il balaya ainsi les multiples invitations de John Boorman d’un irréfutable constat : leurs échanges intellectuels primant le contact physique, pourquoi vouloir deviser dans un café plutôt que converser – pendant des heures, parfois – par téléphone ? Leur amitié n’eût véritablement rien gagné à une rencontre effective.
Soucieux de préserver son œuvre des impuretés de la glose par un silence résolu sur ses intentions et la signification d’une séquence, Kubrick a été, plus ou moins volontairement, l’artisan de sa propre légende, réfractaire aux entretiens comme à la récusation des analyses les plus absconses de ses films. Nous ne tenterons pas d’en entamer la part occulte mais essaierons d’éclairer par les références les plus documentées aux conditions de l’écriture ou aux épisodes saillants de la vie de l’auteur leur importance dans l’élaboration du vocabulaire et de l’esthétique visuels dont la singularité n’offre ni ascendance ni émules.
Il existe des metteurs en scène au nomadisme fécond, souvent subi, dont l’œuvre se décline en fonction des séquences biographiques qui les relient à la culture d’un pays et dont ils s’approprient les codes ; Luis Buñuel, Max Ophuls ou Roman Polanski en constituent les exemples éminents. D’autres comme John Huston, David Lean ou John Boorman tissent une relation privilégiée avec une terre, un lieu incarné, le temps d’un film. Celui-ci se trouve alors pétri du dialogue qui s’instaure entre le créateur et le paysage (sauvage ou urbain) où il implante son histoire. Alain Resnais ou Stanley Kubrick ont eux entrepris d’investir les domaines de l’imaginaire, que la géographie physique échouerait à vouloir circonscrire. L’espace fait alors l’objet d’une relecture à l’aide des mythologies modernes ou des symboles universels qui le redimensionnent et lui accordent une valeur absolue.
Treize films et trois courts-métrages sont ainsi travaillés par le modèle de la réversibilité des continents intimes et des cosmogonies extérieures. Si, selon Bachelard, la langue poétique est la seule à pouvoir réunir dans une même articulation les espaces de l’âme et du cosmos, nul doute que Kubrick, ordonnateur de dédales végétaux, architecturaux ou urbains à l’image des labyrinthes mentaux qu’ils incarnent, a su la doter d’une puissance visionnaire peu égalée. »
« Ma rencontre avec Kubrick aurait pu débuter sous de meilleurs auspices. Depuis des jours, la rumeur enflait au sein de notre groupe de lycéens cinéphiles des années 1980 : 2001, l’odyssée de l’espace allait être prochainement diffusé sur FR3 en début de soirée. L’adaptation par le génial réalisateur du non moins mythique roman d’Arthur C. Clarke allait nous faire franchir un seuil cinématographique aussi décisif que celui de la conversion stellaire du tibia, lancé crânement par l’un des hominidés à l’issue de la séquence The Dawn of Man.
Le soir tant espéré arriva enfin, et c’est avec ferveur que je découvris, ému, les premières images que l’antique et modeste récepteur familial (en noir et blanc) s’évertuait à retransmettre. Si la rixe des anthropoïdes me laissa pantois, la rotation hypnotique de l’hôtel Hilton puis les fastidieux échanges des scientifiques me plongèrent insensiblement dans une torpeur à peine entamée par les non moins soporifiques dialogues entre Bowman et HAL. Honteux de profaner par mon assoupissement un monument du septième art, je m’astreignis à fixer mon attention sur les déambulations des spationautes aux prises avec la duplicité de l’ordinateur.
Las ! leurs déambulations poussives, ponctuées d’expirations métronomiques, eurent bientôt raison de ma persévérance. J’avais quitté l’espace de la vigilance pour celui des songes? Les éruptions incantatoires des chœurs de Ligeti m’extirpèrent brutalement de ma léthargie. La confrontation de Bowman avec son double couché dans un lit de style Louis XV, au fin fond de l’univers, me plongea, elle, dans des abîmes de désarroi. Le lendemain matin, j’esquivai avec précaution toute la sémiologie du fœtus astral ou du monolithe pour m’éclipser en direction des salles de cours?
J’avais pourtant été saisi, entre deux clignements de paupières, par l’énigmatique envoûtement de cet objet filmique inclassable, dont le sens profond échappait à mon entendement. Quel voyage nous était-il donc conté ? Que fallait-il comprendre à cet opéra galactique, dont chaque image semblait produire une surabondance de sens philosophique ? Les trépignements simiesques ou les ballets astraux, j’en étais certain, constituaient les indices à partir desquels le cinéaste, chapitre après chapitre, devait écrire une nouvelle histoire de la connaissance dont il prophétisait l’avènement.
L’année suivante, la découverte tétanisée d’Orange mécanique en salle, dans une mauvaise copie, certes, mais du moins sur grand écran, puis celle des Sentiers de la gloire, pour sa première diffusion à la télévision, suscitèrent ma ferveur avivée par la lecture ébahie du maître ouvrage de Michel Ciment, dont l’acuité d’analyse permettait de mettre au jour des correspondances insoupçonnées entre les films et d’en révéler l’évidente unité. Puis, après des mois d’annonces et de reports, ce fut, en septembre 1987, la sidération de Full Metal Jacket – le premier Kubrick que je découvrais au moment de sa sortie sur les écrans. Il me fallut ensuite patienter douze interminables années pour pénétrer, le cœur fébrile, dans l’immense salle du Bretagne, à Montparnasse, où l’on projetait le chant du cygne, Eyes Wide Shut, par lequel je redoutais d’être déçu ; douze années pendant lesquelles j’avais visionné à l’envi tous les films du maître, consumé par le désir d’approcher l’œuvre interdite Fear and Desire.
On rapportait que le cinéaste en traquait chaque négatif pour le soustraire au public, désavouant cet essai grimaud et prétentieux. Invisible en France jusqu’à sa sortie officielle, en décembre 2012, l’opus liminaire de Kubrick faisait office de Saint-Graal pour les paladins du maître, objet d’une quête fébrile. Grâces soient rendues à mon ami Alexandre Gefen qui, au prix de trois nuits blanches, sonda les arcanes d’Internet afin de dénicher sur le site d’un obscur vidéoclub du Nebraska une version NSCP floue et cendrée ! Au prix de moult efforts oculaires, je parvins à y déceler les motifs en gésine, à savoir, la belligérance comme métaphore des conflits de puissance à l’intérieur d’un système, la désorganisation d’une structure et l’irrésistible emprise de la déraison.
Incidemment, Kubrick côtoya puis supplanta Hitchcock au sein de mon panthéon. Le foisonnement éditorial qui suivit sa mort parvint à peine à étancher ma soif d’informations sur la généalogie et l’exégèse de ses films mythiques. J’appris aussi à démystifier la légende du reclus paranoïaque vérifiant personnellement les copies de tous ses films, dont les émissaires patrouillaient les cinémas du monde entier pour contrôler chaque projecteur et intimer la réfection des salles, sous peine de mise au ban des circuits.
Aujourd’hui, l’œuvre de Kubrick représente pour moi non pas l’aboutissement du cinéma mais peut-être l’une de ses formes les plus accomplies. Si, schématiquement, les metteurs en scène se répartissent entre les formalistes et les analystes, le réalisateur de 2001, l’odyssée de l’espace parvient à conjoindre splendeur plastique et acuité du discours. Chaque film, par sa facture inédite, remet en jeu une nouvelle manière de concevoir l’art du récit par l’acte de naissance de caractères et de figures inoubliables. L’artiste refuse le confort d’un style préétabli et redéfinit, en amont, la manière et le langage cinématographiques exigés par l’histoire.
Éclectisme ne signifie en rien disparité. Film noir ou satire sociale, conte gothique ou péplum, les œuvres de Kubrick s’emparent des problématiques universelles que sont le refoulement des désirs, la quête de l’idéal, l’homme dans la guerre ou la hantise de la folie pour relater comment l’être ordinaire s’arrange de l’espace inconnu où il se trouve plongé. Cet apprivoisement suppose des choix qui ne sont jamais appréciés à l’aune de principes moraux mais selon ce que ces attitudes dévoilent de la part de violence ou de tragique propre à chacun. Moraliste sans dogme, Kubrick pratique un cinéma à hauteur d’homme, dont la cinglante lucidité a pu être interprétée comme une misanthropie ou un cynisme inavoués.
Du peloton symbolique égaré dans la guerre abstraite (Fear and Desire) aux méandres d’une psyché assaillie par la tentation du passage à l’acte (Eyes Wide Shut), le réalisateur aura construit son œuvre autour de l’aspiration humaine à se repositionner dans un univers propice à la désorientation. Alex (Orange mécanique), Docteur Folamour, Jack Torrance (The Shining) ou Bill Harford (Eyes Wide Shut) sont intimement persuadés qu’il existe une Vérité, un accès au sens caché du monde, si l’on parvient à lever les obstacles disposés tout au long du périple. Fort de cette conviction erronée, ils s’épuisent à reconstituer une identité morcelée, quand tout indique, souligne ironiquement Kubrick, qu’ils portent, par égarement ou orgueil, l’intégrale responsabilité de leurs désillusions.
Antipédagogique par excellence, le corpus des treize films édicte dans ses ambiguïtés et l’inconfort de ses postures la vanité de tout dogmatisme. L’être humain n’est jamais assignable à un caractère ou à une nature prédéterminés mais interagit avec les circonstances qui vont mettre en relief les aspects les plus contradictoires de sa personnalité. Le manichéisme, abhorré par l’artiste, génère une fracture indue au sein du monde qu’il découpe artificiellement. De fait, c’est justement cet espace interstitiel, où se défait la structure, que le cinéma de Kubrick choisit de radiographier, en partant du principe qu’il n’est de récit plus stupéfiant que celui de l’anatomie du désordre. Kubrick n’était pas, à cet égard, le dernier à revendiquer le droit à l’équivocité, lui que ses origines et sa culture judaïques n’ont jamais empêché de nourrir une trouble fascination pour le IIIe Reich ni d’épouser la nièce (la fille, selon John Baxter, l’un de ses biographes) de Veit Harlan, réalisateur officiel du régime nazi et du Juif Süss. Peut-être faut-il y voir une vitreuse fascination pour les agencements machiniques promis à la débâcle en raison de la fanatique négation du réel.
L’intelligence du créateur est de ne jamais asséner ses réflexions sur le confort de l’illusion, la nostalgie de l’absolu ou le désenchantement du monde. Marchant sur les brisées d’un Hitchcock, Kubrick aura su adosser l’exigence artistique à l’engouement populaire. Orange mécanique et Shining peuvent ainsi ravir un teenager du Midwest et un agrégé de l’Université tant sont plurivoques les niveaux de lecture. On s’enhardirait même à ajouter que le grand public s’est trouvé plus souvent en adéquation avec les intentions de l’artiste que la critique, parfois désemparée par les ruptures esthétiques ou l’absence de message explicite.
Un seul plan suffit pourtant à se convaincre d’un génie à l’œuvre. Le plus imperceptible cadre, la plus infime nuance de jeu ou la moindre note de musique relèvent de choix délibérés qui engagent éthiquement le cinéaste. Son perfectionnisme obsessionnel, présent à chaque étape de la conception, assorti de sa connaissance des différents postes – il assure, dès son premier opus, l’écriture du scénario, la photographie et le montage –, lui octroie la complète maîtrise d’un film dont il revendique la facture et assume la composition.
Auteur complet, le créateur de Barry Lyndon s’ingénie à conduire les possibilités offertes par son art dans leurs ultimes retranchements – il démontre aux ingénieurs de Zeiss, calculs de physique à l’appui, la possibilité théorique de façonner la courbure des lentilles afin de filmer à la seule lumière de candélabres, résolument convaincu de la nécessaire soumission de la technique aux commandements de l’art. L’expérience malheureuse de Spartacus, où il dut remplacer au pied levé Anthony Mann, congédié par Kirk Douglas, et multiplier les compromis humiliants, lui a enseigné l’intransigeance et le refus des concessions. Du choix de l’histoire au final cut, chaque étape du processus créatif est gouvernée par une semblable volonté de conformation à l’intérêt du récit. Nul effet, nulle vétille, ne doivent être négligés par cet homme capable de se perdre en spéculations au mixage sur la différence de texture sonore entre le bruit de pas sur une terre meuble et sur un sol détrempé – pour ses techniciens, il était phrase que le maestro ne prononcerait jamais : “Fais preuve d’initiative et ne m’ennuie pas avec les détails.” L’approximation ne saurait trouver place dans cette dynamique, qui ne connaît pas d’assistant subalterne. À cet égard, Kubrick confiait avoir rêvé dans sa jeunesse de devenir chef d’orchestre ; il ajouterait plus tard général. Contrairement aux idées reçues, le réalisateur était disposé à écouter toute suggestion susceptible de servir l’œuvre, qu’importât le rang hiérarchique du collaborateur improvisé. Le concierge du studio lui-même recevait un exemplaire du scénario au cas où, selon la formule consacrée, “il aurait une idée”.
L’identification de Kubrick à l’art cinématographique relève à ce point de l’évidence que l’on peine à imaginer la transposition de ses œuvres dans un autre média. Docteur Folamour, Shining et, bien entendu, 2001, l’odyssée de l’espace n’existent que par la fusion du mouvement, de la musique et de la parole au sein d’un même langage. Le cinéma marque l’apogée ou à tout le moins l’idéale conjonction de toutes les formes d’art, dont il épuise savamment les ressources. Sa démarche n’exclut donc pas une sorte de radicalité dans les choix (les stases contemplatives de 2001, l’odyssée de l’espace, l’abstraction graphique de Shining, le picturalisme de Docteur Folamour, etc.) qui réussissent l’exploit de situer en bonne place au box-office des films dont certaines séquences relèveraient plutôt de l’installation muséale ! L’œuvre kubrickienne n’est ni tributaire d’une idée ni asservie à une démonstration. Les interrogations ou conflits personnels qui sous-tendent l’histoire trouvent un écho immédiat chez le spectateur, qu’emportent les propositions visuelles et la polyphonie des situations. L’harmonie parfaite entre la dramaturgie et le rythme adopté représente le souci permanent d’un réalisateur pour lequel le montage fournit au cinéma son identité absolue – quand le scénario et l’interprétation, eux, ont déjà eu leurs prédécesseurs dans la littérature et le théâtre.
L’acte cinématographique est un apostolat, et Kubrick l’accomplit avec une gravité scrupuleuse. Le prix à payer est celui d’une piètre fécondité. L’homme qui déclarait, lors de la remise du prix D. W. Griffith pour l’ensemble de son œuvre, que “la réalisation d’un film s’apparentait à l’écriture de Guerre et paix à bord d’une autotamponneuse au milieu d’une fête foraine” était le premier navré du temps écoulé entre ses derniers films, mais il partait du principe que l’œuvre allait l’accompagner durant toute son existence, avec ses failles ou ses lacunes. Dans ces conditions, tout compromis aurait relevé de la renonciation voire de la faute morale ! Et c’est sans doute cette identification de l’homme à l’œuvre, cette collusion entre le créateur et son travail, qui expliquent le retrait de Kubrick à partir des années 1970, objet de conjectures infondées. La fréquentation du milieu du cinéma l’avait à ce point convaincu de son inanité qu’il se gardait de la compagnie des critiques ou des producteurs, recevant beaucoup plus volontiers dans son manoir de Childwickbury, outre des prix Nobel, plusieurs centaines d’invités à l’occasion de garden parties. Ce New-Yorkais avait fait de ses demeures d’Abbots Mead puis de Childwickbury des lieux stratégiques à partir desquels il pouvait organiser les tournages et procéder à la postproduction des films, sans délaisser la quiétude bucolique d’une vie dévolue à sa famille – l’autre passion de sa vie – et à ses six chiens et nombreux chats, dont il tenait à changer la litière personnellement sous le regard éberlué des visiteurs de passage.
Voyageur fort occasionnel puis farouchement sédentaire (les cinq jours de l’été 1961 qu’il consacre à l’arpentage des plages du Débarquement et des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, en compagnie de son épouse, sont les congés les plus longs qu’il se soit accordés), Kubrick met à profit les apports des nouvelles technologies (il se targuait de figurer parmi les premiers Britanniques à posséder un fax puis un traitement de texte) pour effectuer depuis son domicile toutes les tâches incombant à son activité ou entretenir ses relations sociales. Il balaya ainsi les multiples invitations de John Boorman d’un irréfutable constat : leurs échanges intellectuels primant le contact physique, pourquoi vouloir deviser dans un café plutôt que converser – pendant des heures, parfois – par téléphone ? Leur amitié n’eût véritablement rien gagné à une rencontre effective.
Soucieux de préserver son œuvre des impuretés de la glose par un silence résolu sur ses intentions et la signification d’une séquence, Kubrick a été, plus ou moins volontairement, l’artisan de sa propre légende, réfractaire aux entretiens comme à la récusation des analyses les plus absconses de ses films. Nous ne tenterons pas d’en entamer la part occulte mais essaierons d’éclairer par les références les plus documentées aux conditions de l’écriture ou aux épisodes saillants de la vie de l’auteur leur importance dans l’élaboration du vocabulaire et de l’esthétique visuels dont la singularité n’offre ni ascendance ni émules.
Il existe des metteurs en scène au nomadisme fécond, souvent subi, dont l’œuvre se décline en fonction des séquences biographiques qui les relient à la culture d’un pays et dont ils s’approprient les codes ; Luis Buñuel, Max Ophuls ou Roman Polanski en constituent les exemples éminents. D’autres comme John Huston, David Lean ou John Boorman tissent une relation privilégiée avec une terre, un lieu incarné, le temps d’un film. Celui-ci se trouve alors pétri du dialogue qui s’instaure entre le créateur et le paysage (sauvage ou urbain) où il implante son histoire. Alain Resnais ou Stanley Kubrick ont eux entrepris d’investir les domaines de l’imaginaire, que la géographie physique échouerait à vouloir circonscrire. L’espace fait alors l’objet d’une relecture à l’aide des mythologies modernes ou des symboles universels qui le redimensionnent et lui accordent une valeur absolue.
Treize films et trois courts-métrages sont ainsi travaillés par le modèle de la réversibilité des continents intimes et des cosmogonies extérieures. Si, selon Bachelard, la langue poétique est la seule à pouvoir réunir dans une même articulation les espaces de l’âme et du cosmos, nul doute que Kubrick, ordonnateur de dédales végétaux, architecturaux ou urbains à l’image des labyrinthes mentaux qu’ils incarnent, a su la doter d’une puissance visionnaire peu égalée. »
(p. 7-17)


