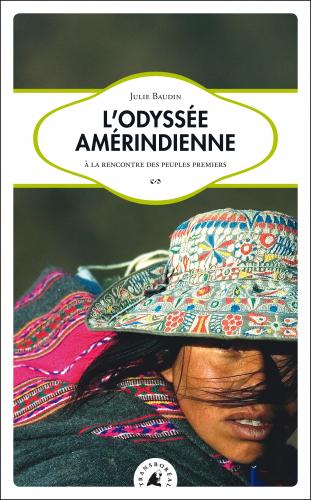
Noatak River ~ 5 avril 2005 :
« Trouver à manger est certes vital, mais ce n’est pas ce qui occupe le plus Gene et Christine en cette saison. Il y a bien d’autres activités – la lecture, le tricot, le “cinéma”, quand on s’autorise à allumer le générateur le temps d’un film passé sur le vieux magnétoscope.
Il y a, chez Gene et Christine, un je-ne-sais-quoi qui nous fait nous sentir ailleurs. Un ailleurs touchant, familier et humble, comme l’est ce couple atypique auquel nous sommes déjà attachés. La chaleur du poêle nous prenant au corps après la gifle cinglante du froid y est sûrement pour quelque chose dans le bien-être que nous éprouvons ! Il y a aussi le cliquetis de l’horloge bancale et perpétuellement en retard d’une trotte. Et la VHF enrouée, toujours à l’affût de la moindre rumeur, qui reste le principal outil de communication malgré la concurrence de la toute jeune ligne téléphonique. Dans un coin trône une pile d’anciens numéros du National Geographic, dont les spécimens décolorés par l’âge (le plus récent remonte à 1987) parviennent toujours à rendre les heures moins longues. La maison de Gene et Christine est un méli-mélo d’instants de vie, de calendriers dépassés, de dessins d’enfants et de cartes postales trentenaires qui prétendent à un pan de mur au même titre qu’un Matisse, et des photos, des dizaines de photos jaunies ou déchirées qui, mesquines, viennent rappeler, sur la fine cloison ou au sein d’un album, un passé doux-amer, une jeunesse méconnaissable.
Des accidents de parcours, ils en ont connu, Gene et Christine. Ils n’ont pas toujours vécu ainsi, dans la quiétude de leur petite maison dans la toundra. Comme la plupart des indigènes alaskans de leur génération, ils furent envoyés à l’école dans les Lower 48 (les “48 d’en bas”, à savoir le reste des États-Unis), dans un établissement strictement réservé aux “Indiens” et aux Eskimos. Non seulement on leur y apprenait à oublier leur langue natale et leur culture (Gene, qui parlait couramment l’iñupiaq, est aujourd’hui complètement anglophone), mais en plus on leur assurait que c’était pour leur bien. L’éducation n’était-elle pas l’unique moyen d’accéder au monde “civilisé” de l’élite blanche états-unienne ? Ce qui n’empêchait pourtant pas qu’on les traitât comme on l’avait toujours fait. Civilisé ou non, l’Indien reste un Indien. On ne se gênait pas pour afficher sur les vitrines des magasins No Indians ou encore Whites only (“Blancs uniquement”), quand on ne proférait pas ouvertement des insultes à leur encontre. On réservait certaines séances de cinéma aux indigènes et aux latinos pour s’assurer qu’ils ne se mêlent pas aux Blancs. Autant de discriminations qui vous forgent un caractère, une vie. Leur baccalauréat en poche, Gene et Christine revinrent au pays. Mais comment vivre comme leurs parents et grands-parents quand ils s’étaient si bien accoutumés au mode de vie occidental ? Chasser ? Pêcher ? Élever des chiens pour se déplacer ? À quoi bon quand, avec quelques morceaux de papier froissé, on pouvait acheter de la nourriture, des vêtements, un Ski-Doo, du gazole. Le choix fut rapidement fait. Christine devint ainsi femme de ménage à l’hôpital.
Gene et Christine s’en sont plutôt bien sortis, même si le salaire de cette dernière s’est longtemps évaporé en bières et autres spiritueux pour nourrir la dépression de son mari. Mais on évite de parler de cela, car l’alcoolisme, qui touche presque tout le monde dans l’Arctique, reste un sujet tabou et l’alcool une substance bannie ; à tel point que les habitants de Kotzebue eux-mêmes ont fait interdire la vente de spiritueux dans la communauté, ce qui en a par ailleurs encouragé le trafic illicite. Gene a gardé de cette période, aujourd’hui révolue, de grosses poches pleines de tristesse sous ses yeux noirs. Et une Bible, dont il lit quelques pages à voix basse dès qu’il en a l’occasion. Car, paradoxalement, après avoir détruit les peuples en les acculturant, les Églises chrétiennes s’en sont fait les sauveurs en les sortant de l’alcoolisme.
“Gene a beaucoup changé !” soupire Christine en nous déballant une série de photos tachées de visages lointains.
Gene était bel homme plus jeune. Quant à Christine, le temps ne l’a pas épargnée. Sa fine silhouette aux accents asiatiques lui a fait faux bond depuis belle lurette. Mais elle s’en fiche. Car depuis toujours, elle est persuadée d’être entre les mains de Dieu et a une confiance inouïe en la vie. Cela explique la présence d’un Jésus grandeur nature flottant dans sa toge fuchsia contre l’un des murs de la pièce principale.
Quoique sous la protection d’une personne aussi influente que le fils de Dieu, Christine a beaucoup souffert. Bien avant d’être envoyée à Chemawa High School, dans l’Oregon, son père lui enseignait déjà à renier ses ancêtres iñupiat. Lui-même de mère indigène mais de père suédois (un marin qui avait un jour échoué en Alaska puis s’était laissé séduire par le charme des femmes du coin), il avait formellement interdit à son épouse de converser en langue iñupiaq en présence de ses enfants. Aux yeux de Christine, qui avait toujours parlé anglais comme n’importe quel citoyen nord-américain, il était alors incompréhensible qu’on puisse l’assimiler à une Native. Pour quelle raison lui refusait-on certains lieux publics alors qu’elle portait en elle du sang blanc ? Ni vraiment eskimo, ni vraiment blanche. Qu’était-elle alors ?
Aujourd’hui, Gene et Christine ont cessé leurs tergiversations avec l’existence. En quittant la ville pour réapprendre à chasser et à pêcher, ils mènent une vie simple et, de mon point de vue, idyllique. Nulle obligation de travailler pour d’autres. Seule la survie les préoccupe. Ils ont peu de biens, certes, mais ils en sont les propriétaires. Chaque année, quelques milliers de dollars (ce qui est bien peu sous ces latitudes) tombent du ciel, ou presque, jusque sur leur compte en banque : les revenus correspondant à l’extraction du pétrole que leur verse l’État d’Alaska d’une part ; les dividendes de la société régionale dont ils sont actionnaires d’autre part. Tout juste de quoi compléter leur régime de quelques légumes et autres friandises, et assouvir la soif de leur motoneige et de leur générateur. Le silence de l’Arctique a un prix : l’humilité et le dénuement.
Je comprends ce que veulent dire Gene et Christine lorsqu’ils affirment avoir “réappris” les gestes quotidiens. C’est qu’il n’est pas si simple d’aller chercher du bois dans la nature matin et soir, d’allumer et d’entretenir un feu, de couper la neige en gros blocs pour la faire fondre, d’éviscérer des poissons congelés, de découper un orignal ou un caribou (j’entends encore craquer les pattes de l’animal auquel on doit briser les tibias afin de le dépecer plus facilement), puis de manger de l’orignal et du caribou – demandez donc à une végétarienne de mon espèce qui a, depuis, renoncé à sa chasteté alimentaire ! Sans compter l’art de la chasse qui est loin d’être inné. Car une fois l’animal repéré, il s’agit de le tuer. Jadis, quand le fusil n’avait pas encore fait son apparition, il fallait s’approcher le plus près possible du gibier pour espérer l’abattre. Silence et concentration étaient de rigueur. Aujourd’hui, les méthodes ont changé, ce qui ne signifie pas pour autant que la chasse soit devenue une activité à la portée de tout le monde. Pour le caribou, par exemple, on pourrait croire qu’il suffit de prendre la motoneige et de foncer à travers la toundra. À moins d’un mile, on devrait tomber sur un troupeau de bêtes qui, en cette saison, remontent en masse vers le nord. Cependant, les choses ne sont pas si simples. Le problème n’est pas le caribou : c’est l’homme. »
D’El Porvenir à Cartí Yantupu ~ 5 mai 2006 (p. 199-205)
Pitka, au bord du salar d’Uyuni ~ 18 janvier 2007 (p. 307-311)
Extrait court
« Trouver à manger est certes vital, mais ce n’est pas ce qui occupe le plus Gene et Christine en cette saison. Il y a bien d’autres activités – la lecture, le tricot, le “cinéma”, quand on s’autorise à allumer le générateur le temps d’un film passé sur le vieux magnétoscope.
Il y a, chez Gene et Christine, un je-ne-sais-quoi qui nous fait nous sentir ailleurs. Un ailleurs touchant, familier et humble, comme l’est ce couple atypique auquel nous sommes déjà attachés. La chaleur du poêle nous prenant au corps après la gifle cinglante du froid y est sûrement pour quelque chose dans le bien-être que nous éprouvons ! Il y a aussi le cliquetis de l’horloge bancale et perpétuellement en retard d’une trotte. Et la VHF enrouée, toujours à l’affût de la moindre rumeur, qui reste le principal outil de communication malgré la concurrence de la toute jeune ligne téléphonique. Dans un coin trône une pile d’anciens numéros du National Geographic, dont les spécimens décolorés par l’âge (le plus récent remonte à 1987) parviennent toujours à rendre les heures moins longues. La maison de Gene et Christine est un méli-mélo d’instants de vie, de calendriers dépassés, de dessins d’enfants et de cartes postales trentenaires qui prétendent à un pan de mur au même titre qu’un Matisse, et des photos, des dizaines de photos jaunies ou déchirées qui, mesquines, viennent rappeler, sur la fine cloison ou au sein d’un album, un passé doux-amer, une jeunesse méconnaissable.
Des accidents de parcours, ils en ont connu, Gene et Christine. Ils n’ont pas toujours vécu ainsi, dans la quiétude de leur petite maison dans la toundra. Comme la plupart des indigènes alaskans de leur génération, ils furent envoyés à l’école dans les Lower 48 (les “48 d’en bas”, à savoir le reste des États-Unis), dans un établissement strictement réservé aux “Indiens” et aux Eskimos. Non seulement on leur y apprenait à oublier leur langue natale et leur culture (Gene, qui parlait couramment l’iñupiaq, est aujourd’hui complètement anglophone), mais en plus on leur assurait que c’était pour leur bien. L’éducation n’était-elle pas l’unique moyen d’accéder au monde “civilisé” de l’élite blanche états-unienne ? Ce qui n’empêchait pourtant pas qu’on les traitât comme on l’avait toujours fait. Civilisé ou non, l’Indien reste un Indien. On ne se gênait pas pour afficher sur les vitrines des magasins No Indians ou encore Whites only (“Blancs uniquement”), quand on ne proférait pas ouvertement des insultes à leur encontre. On réservait certaines séances de cinéma aux indigènes et aux latinos pour s’assurer qu’ils ne se mêlent pas aux Blancs. Autant de discriminations qui vous forgent un caractère, une vie. Leur baccalauréat en poche, Gene et Christine revinrent au pays. Mais comment vivre comme leurs parents et grands-parents quand ils s’étaient si bien accoutumés au mode de vie occidental ? Chasser ? Pêcher ? Élever des chiens pour se déplacer ? À quoi bon quand, avec quelques morceaux de papier froissé, on pouvait acheter de la nourriture, des vêtements, un Ski-Doo, du gazole. Le choix fut rapidement fait. Christine devint ainsi femme de ménage à l’hôpital.
Gene et Christine s’en sont plutôt bien sortis, même si le salaire de cette dernière s’est longtemps évaporé en bières et autres spiritueux pour nourrir la dépression de son mari. Mais on évite de parler de cela, car l’alcoolisme, qui touche presque tout le monde dans l’Arctique, reste un sujet tabou et l’alcool une substance bannie ; à tel point que les habitants de Kotzebue eux-mêmes ont fait interdire la vente de spiritueux dans la communauté, ce qui en a par ailleurs encouragé le trafic illicite. Gene a gardé de cette période, aujourd’hui révolue, de grosses poches pleines de tristesse sous ses yeux noirs. Et une Bible, dont il lit quelques pages à voix basse dès qu’il en a l’occasion. Car, paradoxalement, après avoir détruit les peuples en les acculturant, les Églises chrétiennes s’en sont fait les sauveurs en les sortant de l’alcoolisme.
“Gene a beaucoup changé !” soupire Christine en nous déballant une série de photos tachées de visages lointains.
Gene était bel homme plus jeune. Quant à Christine, le temps ne l’a pas épargnée. Sa fine silhouette aux accents asiatiques lui a fait faux bond depuis belle lurette. Mais elle s’en fiche. Car depuis toujours, elle est persuadée d’être entre les mains de Dieu et a une confiance inouïe en la vie. Cela explique la présence d’un Jésus grandeur nature flottant dans sa toge fuchsia contre l’un des murs de la pièce principale.
Quoique sous la protection d’une personne aussi influente que le fils de Dieu, Christine a beaucoup souffert. Bien avant d’être envoyée à Chemawa High School, dans l’Oregon, son père lui enseignait déjà à renier ses ancêtres iñupiat. Lui-même de mère indigène mais de père suédois (un marin qui avait un jour échoué en Alaska puis s’était laissé séduire par le charme des femmes du coin), il avait formellement interdit à son épouse de converser en langue iñupiaq en présence de ses enfants. Aux yeux de Christine, qui avait toujours parlé anglais comme n’importe quel citoyen nord-américain, il était alors incompréhensible qu’on puisse l’assimiler à une Native. Pour quelle raison lui refusait-on certains lieux publics alors qu’elle portait en elle du sang blanc ? Ni vraiment eskimo, ni vraiment blanche. Qu’était-elle alors ?
Aujourd’hui, Gene et Christine ont cessé leurs tergiversations avec l’existence. En quittant la ville pour réapprendre à chasser et à pêcher, ils mènent une vie simple et, de mon point de vue, idyllique. Nulle obligation de travailler pour d’autres. Seule la survie les préoccupe. Ils ont peu de biens, certes, mais ils en sont les propriétaires. Chaque année, quelques milliers de dollars (ce qui est bien peu sous ces latitudes) tombent du ciel, ou presque, jusque sur leur compte en banque : les revenus correspondant à l’extraction du pétrole que leur verse l’État d’Alaska d’une part ; les dividendes de la société régionale dont ils sont actionnaires d’autre part. Tout juste de quoi compléter leur régime de quelques légumes et autres friandises, et assouvir la soif de leur motoneige et de leur générateur. Le silence de l’Arctique a un prix : l’humilité et le dénuement.
Je comprends ce que veulent dire Gene et Christine lorsqu’ils affirment avoir “réappris” les gestes quotidiens. C’est qu’il n’est pas si simple d’aller chercher du bois dans la nature matin et soir, d’allumer et d’entretenir un feu, de couper la neige en gros blocs pour la faire fondre, d’éviscérer des poissons congelés, de découper un orignal ou un caribou (j’entends encore craquer les pattes de l’animal auquel on doit briser les tibias afin de le dépecer plus facilement), puis de manger de l’orignal et du caribou – demandez donc à une végétarienne de mon espèce qui a, depuis, renoncé à sa chasteté alimentaire ! Sans compter l’art de la chasse qui est loin d’être inné. Car une fois l’animal repéré, il s’agit de le tuer. Jadis, quand le fusil n’avait pas encore fait son apparition, il fallait s’approcher le plus près possible du gibier pour espérer l’abattre. Silence et concentration étaient de rigueur. Aujourd’hui, les méthodes ont changé, ce qui ne signifie pas pour autant que la chasse soit devenue une activité à la portée de tout le monde. Pour le caribou, par exemple, on pourrait croire qu’il suffit de prendre la motoneige et de foncer à travers la toundra. À moins d’un mile, on devrait tomber sur un troupeau de bêtes qui, en cette saison, remontent en masse vers le nord. Cependant, les choses ne sont pas si simples. Le problème n’est pas le caribou : c’est l’homme. »
(p. 24-27)
D’El Porvenir à Cartí Yantupu ~ 5 mai 2006 (p. 199-205)
Pitka, au bord du salar d’Uyuni ~ 18 janvier 2007 (p. 307-311)
Extrait court


