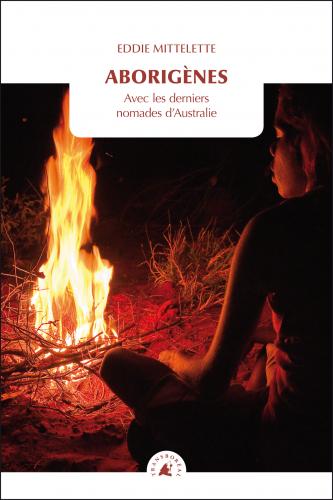
Initiation :
« Il me tarde de partir en week-end car toute la semaine, depuis la promesse de Clifford, l’excitation m’a empêché de dormir. Pour beaucoup d’entre nous, d’ailleurs, le vendredi est un grand jour. Les enfants ont attendu avec impatience le retentissement de la cloche, laissant derrière eux un champ de ruines. Après avoir redonné un semblant d’apparence aux salles de classe, je m’apprête à rentrer au mobile home de Jenny où je loge cette semaine. Déjà, je tombe sur le Prado de Clifford qui ronronne dans une forte odeur de diesel, les fenêtres ouvertes vomissant des bras d’enfants survoltés. Ils m’attendent de pied ferme. Exhorté par les cris, je décide que mes vêtements du jour feront l’affaire, me précipite sous l’appentis pour attraper duvet et tente, oublie l’essentiel et jette le tout par une fenêtre qui engloutit mes effets en un éclair. À peine ai-je le temps de me glisser à l’intérieur que nous disparaissons dans un panache de poussière.
À l’évidence, l’habitacle ne fait pas l’objet de toutes les attentions. Le tableau de bord est lacéré et les sièges crachent de la mousse et du sable lorsqu’on s’y assoit. La voiture sert autant à transporter la famille que des outils ou du bois pour le feu. Lizzie – la femme de Clifford – a eu la gentillesse de me laisser le siège passager, pour m’épargner les gesticulations des six enfants qui se partagent la banquette et le coffre avec deux chiens. Cette sortie vers l’inconnu est une aventure. Nous avalons les kilomètres de piste à vive allure, tandis que les enceintes diffusent de la country et des chansons de Midnight Oil. Malgré l’impopularité de son chanteur Peter Garrett en tant que ministre de l’Environnement, le groupe bénéficie toujours d’une fidélité indéfectible au sein des communautés, pour son implication dans la cause aborigène et ses concerts donnés à la fin des années 1980 dans les régions reculées.
Sans ralentir ni nous soucier d’éventuels véhicules arrivant en face, nous franchissons le filet de la De Grey à vive allure. J’ai juste le temps d’apercevoir en bord de piste les restes des deux émeus gisant dans des cendres. Ce fut une belle fête, à en juger les bouteilles et les détritus abandonnés sur la berge. Je déplore trop souvent les souillures aux abords des routes, et la responsabilité est collective. Une telle abondance d’emballages est un phénomène récent et, bien que le sujet soit au cœur des préoccupations, il faudra encore une génération pour que la sensibilisation menée auprès des jeunes porte ses fruits.
Une vingtaine de kilomètres plus loin, après avoir franchi la vaste plaine où cohabitent émeus et kangourous, nous parvenons à l’embranchement avec la route principale. Nous obliquons vers l’est et roulons cinquante autres kilomètres sur la Great Northern Highway jusqu’au roadhouse de Pardoo. Clifford et Lizzie y achètent du fil de nylon, plusieurs boîtes d’hameçons et une poignée de munitions pour le fusil. Puis, sans traîner, nous revenons d’autant sur nos pas et nous engageons vers le nord sur un étroit sentier à demi recouvert par la végétation. Même en roulant à faible allure à vélo, je n’aurais pu apercevoir ce chemin, et je pressens qu’il s’agit là d’un itinéraire seulement connu des Aborigènes locaux. Nous passons rapidement une colline et la route bitumée disparaît dans les rétroviseurs. L’instant qui suit, j’ai le sentiment de fouler une terre vierge. Le bush s’épaissit et nous submerge tel un sous-marin qui sombrerait dans les abysses. Comme si Clifford le conduisait à l’instinct, le Toyota chemine à l’aveuglette en fendant les rameaux d’acacia, qui collent au passage une belle gifle à Little Clifford – l’un de ses fils, nommé ainsi pour sa ressemblance frappante avec son père, et ce dès sa naissance – qui rêvassait sur le rebord de sa vitre abaissée. Il n’a pas vu le coup venir. Rires et moqueries éclatent sur le dos du garçonnet piqué au vif, déclenchant les aboiements déchaînés des chiens. Mais l’agitation et les pleurnicheries ne couvrent même pas le grincement suraigu des griffures sur la carrosserie, ni le frottement du châssis sur la crête que forment les deux ornières que nos roues contribuent à creuser. Clifford, menton sur le volant et yeux rivés sur le bout du capot, augmente le régime du moteur pour maintenir l’adhérence et nous éviter un numéro d’équilibriste : même s’il était possible de pousser un tel véhicule, nous ne pourrions nous en extraire que par les fenêtres !
La sortie est en vue. Nous nous extirpons de l’étreinte végétale, et le soleil aveuglant inonde à nouveau l’habitacle. Devant nous, une plaine de Spinifex étend son tapis vert-de-gris aux notes bleutées. Mes pensées naviguent sur ce sentier qui s’éloigne et plonge derrière l’horizon comme un sillage orangé sur une mer étale.
Pan ! La déflagration claque comme un fouet. Mes oreilles sifflent. Du fusil s’élève une volute de fumée. Le canon posé sur le rétroviseur extérieur, Clifford ajuste son deuxième tir, qui soulève un nuage de sable près de la queue d’un marlu sérieusement inquiet de ses chances d’en réchapper. Ce kangourou roux se trouve à 300 mètres environ. D’un bond agile, notre repas décanille sans réclamer son reste et disparaît. Comme il est trop tard pour le recharger, Clifford passe son fusil aux enfants et enclenche la première sans mot dire. Grommellements et messes basses à l’arrière. Tous retirent leurs doigts de leurs oreilles : j’étais manifestement le seul à ne pas avoir repéré le kangourou. Je comprends enfin le regard absorbé de Clifford depuis que nous nous sommes engagés sur cette piste : concentré sur la conduite, il scrute sans répit chaque recoin du bush à l’affût d’un gibier providentiel. Le Clézio décrivait une pareille acuité visuelle chez l’homme du désert, “capable de suivre les nuances, d’apercevoir les détails, de repérer une ombre fugitive, un reflet, un souffle”.
La demi-heure qui suit voit défiler une piste sans variations majeures. Puis, au détour d’une colline, le Spinifex devient épars et le sable virant au blanc dévoile les méandres de la De Grey. Au loin, son embouchure se confond avec le ciel et l’océan Indien. Des ornières sinueuses nous mènent au cap Condon – nommé Walalngunya par le peuple nyangumarta – barré par une mangrove impénétrable. Alors que nous gravissons le bref promontoire surplombant cette barrière naturelle, la perspective qui s’ouvre nous invite au silence. La baie dévoile sous nos yeux sa gradation de teintes allant du turquoise au céruléen. L’embouchure, son poumon, se gonfle du flot des marées.
Arrivées avant nous, deux familles sont déjà assises à l’abri du vent, entre les voitures disposées en arc de cercle. Une dizaine d’enfants sont présents. Je remarque une nette différence dans leur attitude : ils paraissent plus calmes et détendus qu’ils ne le sont en classe. Il y a notamment Florita avec sa silhouette gracile, ses yeux larges mais fuyants et ses dents du bonheur. Certains se démarquent naturellement, comme Joshia, ou bien Kimarl avec son épaisse chevelure ébouriffée d’un noir de jais. Comme nous tous, il semble apaisé par l’endroit, lui qui d’ordinaire traîne son air renfrogné. Il ne faut pourtant pas s’y fier : j’ai rarement décelé autant de bienveillance chez un enfant.
L’heure n’est pas au repos : le temps file et le soleil étire les ombres. Clifford distribue des consignes à tout le monde avant que la nuit ne nous surprenne. Le problème du dîner n’étant pas résolu, il s’installe au volant de son Prado, le fusil calé entre les genoux. Avant de repartir, il me charge de collecter une quantité de bois capable d’alimenter un brasier. Puis il me met en garde à propos des sites interdits avec un ton qui dissuade toute velléité de désobéir : “Ne t’aventure pas vers ces arbres, dit-il en pointant un bosquet éloigné, c’est un lieu pour les femmes. L’esprit-enfant habite cet endroit et féconde les mères qui le visitent. Sinon, tu as le droit de gravir cette butte sableuse et d’observer ses flancs jusqu’au sentier qui le contourne, mais tu ne dois pas mettre un pied au-delà de cette limite car c’est un site cérémoniel réservé aux hommes.”
Selon ses recommandations, ma liberté de mouvement se réduit aux plages ainsi qu’à une colline offrant une vue imprenable sur les environs. Puis-je espérer mieux que cette quarantaine ? Dans ce coin de paradis, une telle contrainte se transforme en privilège, de mon point de vue tout du moins. Car, même si la tradition s’est assouplie et adaptée à notre époque, une croyance aborigène toujours en usage dit qu’un étranger ou un individu qui se hasarde aux abords des sites réservés aux personnes du sexe opposé risque de tomber malade et de mourir, ou bien s’expose à un châtiment sévère. Jadis, enfreindre ces règles était ainsi puni de mort si l’intrus agissait à dessein. Personnellement, je n’ai aucun désir de franchir les limites qui me sont imposées, même si je doute qu’un sort funeste me soit réservé. En qualité de Yatilypa, Clifford m’a placé sous son égide et sa parole fait autorité. M’ayant confié à Lizzie, il repart avec deux de ses fils, Elysah et Creysley, bien décidés à nous faire oublier l’épisode du marlu manqué. L’inventaire des vivres embarqués leur laisse de toute façon peu le choix. Parmi les swags et les couvertures, je ne remarque rien de consistant pour soulager l’appétit d’une quinzaine d’ogres, n’étaient les aliments de base auxquels je pouvais m’attendre : un sac de farine blanche, des sachets de thé noir, du sucre et une boîte de lait en poudre. Il ne s’agit pas d’une négligence de leur part, mais plutôt d’un excès de précautions de la mienne. La nourriture foisonne dans la nature. Avant de former une jeune équipe pour la recherche de bois sec, je fais repartir le feu de Jackson, un vieil oncle de Clifford avare de conversation. Emmitouflé dans une chemise épaisse et les pieds fourrés au chaud sous son chien endormi, il murmure au vent une foule d’histoires qui me sont incompréhensibles. Par respect, je devance ses envies en faisant chauffer l’eau du thé et en l’installant confortablement, car depuis plusieurs semaines la saison du wantajarra fait chuter les températures dès que le crépuscule étouffe les derniers rayons.
Deux heures se sont écoulées et le retour tardif des chasseurs fait régner l’ennui autour du feu. “Ils ont probablement dû étendre leur zone de chasse”, confie Lizzie, rompant un long silence. Elle se montre pessimiste sur nos chances de manger du marlu ce soir, car la saison peu généreuse en pluies confine les grands marsupiaux à proximité des sources d’eau permanentes. À peine nous fait-elle part de ses doutes que des hoquets charriés par le vent retentissent dans la nuit opaque. Au terme de minutes interminables, deux phares oscillent à travers la plaine, accompagnés du couinement des amortisseurs. Le Prado débouche au détour de la colline et se dirige vers nous, projetant soudainement nos ombres sur les acacias qui encadrent le camp. Les enfants hurlent de joie à la vue d’une masse sombre attachée sur le capot et, tandis qu’ils se précipitent à sa rencontre, Lizzie tisonne les braises afin de ranimer le feu.
L’instant suivant, un oiseau s’abat lourdement à mes pieds, faisant voler plumules et duvet. La carcasse gisante pointe sur moi son œil torve qui exprime toute la soudaineté de la mort. C’est une jarrki, une magnifique outarde australienne, haute d’un bon mètre cinquante et au plumage blanc éclatant qui, lorsqu’elle ne succombe pas sous le feu nourri des carabines, arbore un long cou qui domine la plaine : une invitation pour le chasseur ! Quand elle ne croise pas un groupe d’Aborigènes, elle mène une existence paisible et sans prédateurs.
— C’est une cible inratable, m’explique Clifford, indifférente aux balles qui pleuvent autour d’elle. Elle ne s’échappe jamais. Tu as le temps de recharger, de te préparer une prise de tabac et de lui en mettre une autre si la première n’a pas suffi.
Une prouesse tout de même, dans cette nuit où la lune ne permet guère de distinguer le vivant de l’inerte. Selon moi, son mérite est intact ; un estomac vide ne s’encombre pas de considérations morales. À en juger l’enthousiasme ambiant, cette alternative au marlu n’en est pas moins un morceau de choix. Lizzie ramasse la bête par le cou pour la dénuder. À la lueur du feu brasillant, elle exécute une plumaison précise, rapide et qui dévoile l’orifice sanglant à l’origine du trépas. Son doigt fouille consciencieusement la chair rose mais, la balle restant introuvable, Lizzie poursuit la préparation de la jarrki sur le tas de rémiges blanches aux pointes noires et de duvet couleur d’albâtre. Sous les regards affamés, elle arrache les abats à pleines mains puis roule l’oiseau sur les braises afin de le débarrasser des plumettes rebelles. Une délicieuse odeur de chair roussie se répand alors dans le camp. Si certains repas sont uniquement constitués de végétaux, celui-ci sera fait de viande : le guwiyi. Ce festin doit certainement ressembler aux repas uniques pris jadis au crépuscule, qui couronnaient la journée passée à collecter et à grignoter des fruits et les délicieuses wuukarta – les fourmis à miel.
Les braises rougies annoncent le début de la cuisson à l’étouffée. Sachant qu’il faudra être patient, Joshia se rapproche de moi comme s’il voulait prendre part à mon apprentissage. Ainsi qu’à chacun des individus adultes réunis ce soir, un rôle m’est attribué. Clifford me tend une pelle afin que je creuse près du waru – le feu – un trou assez profond pour ensevelir l’oiseau. Ma tâche terminée, Lizzie se charge d’en tapisser le fond de braises, puis d’une couche de sable chaud pour éviter de calciner la chair. Clifford y place soigneusement la jarrki entière qu’ensuite, inversant la technique initiale, il recouvre de sable et enfin de braises. Des piétinements sur le monticule fumant achèvent de constituer ce four rudimentaire. Une cuisson lente et à cœur, qui rappelle les pratiques des Maoris, des Mapuches et des Bédouins pour les outardes. »
L’ère des derniers arpenteurs (p. 33-38)
Punmu, le grand rassemblement (p. 173-177)
Extrait court
« Il me tarde de partir en week-end car toute la semaine, depuis la promesse de Clifford, l’excitation m’a empêché de dormir. Pour beaucoup d’entre nous, d’ailleurs, le vendredi est un grand jour. Les enfants ont attendu avec impatience le retentissement de la cloche, laissant derrière eux un champ de ruines. Après avoir redonné un semblant d’apparence aux salles de classe, je m’apprête à rentrer au mobile home de Jenny où je loge cette semaine. Déjà, je tombe sur le Prado de Clifford qui ronronne dans une forte odeur de diesel, les fenêtres ouvertes vomissant des bras d’enfants survoltés. Ils m’attendent de pied ferme. Exhorté par les cris, je décide que mes vêtements du jour feront l’affaire, me précipite sous l’appentis pour attraper duvet et tente, oublie l’essentiel et jette le tout par une fenêtre qui engloutit mes effets en un éclair. À peine ai-je le temps de me glisser à l’intérieur que nous disparaissons dans un panache de poussière.
À l’évidence, l’habitacle ne fait pas l’objet de toutes les attentions. Le tableau de bord est lacéré et les sièges crachent de la mousse et du sable lorsqu’on s’y assoit. La voiture sert autant à transporter la famille que des outils ou du bois pour le feu. Lizzie – la femme de Clifford – a eu la gentillesse de me laisser le siège passager, pour m’épargner les gesticulations des six enfants qui se partagent la banquette et le coffre avec deux chiens. Cette sortie vers l’inconnu est une aventure. Nous avalons les kilomètres de piste à vive allure, tandis que les enceintes diffusent de la country et des chansons de Midnight Oil. Malgré l’impopularité de son chanteur Peter Garrett en tant que ministre de l’Environnement, le groupe bénéficie toujours d’une fidélité indéfectible au sein des communautés, pour son implication dans la cause aborigène et ses concerts donnés à la fin des années 1980 dans les régions reculées.
Sans ralentir ni nous soucier d’éventuels véhicules arrivant en face, nous franchissons le filet de la De Grey à vive allure. J’ai juste le temps d’apercevoir en bord de piste les restes des deux émeus gisant dans des cendres. Ce fut une belle fête, à en juger les bouteilles et les détritus abandonnés sur la berge. Je déplore trop souvent les souillures aux abords des routes, et la responsabilité est collective. Une telle abondance d’emballages est un phénomène récent et, bien que le sujet soit au cœur des préoccupations, il faudra encore une génération pour que la sensibilisation menée auprès des jeunes porte ses fruits.
Une vingtaine de kilomètres plus loin, après avoir franchi la vaste plaine où cohabitent émeus et kangourous, nous parvenons à l’embranchement avec la route principale. Nous obliquons vers l’est et roulons cinquante autres kilomètres sur la Great Northern Highway jusqu’au roadhouse de Pardoo. Clifford et Lizzie y achètent du fil de nylon, plusieurs boîtes d’hameçons et une poignée de munitions pour le fusil. Puis, sans traîner, nous revenons d’autant sur nos pas et nous engageons vers le nord sur un étroit sentier à demi recouvert par la végétation. Même en roulant à faible allure à vélo, je n’aurais pu apercevoir ce chemin, et je pressens qu’il s’agit là d’un itinéraire seulement connu des Aborigènes locaux. Nous passons rapidement une colline et la route bitumée disparaît dans les rétroviseurs. L’instant qui suit, j’ai le sentiment de fouler une terre vierge. Le bush s’épaissit et nous submerge tel un sous-marin qui sombrerait dans les abysses. Comme si Clifford le conduisait à l’instinct, le Toyota chemine à l’aveuglette en fendant les rameaux d’acacia, qui collent au passage une belle gifle à Little Clifford – l’un de ses fils, nommé ainsi pour sa ressemblance frappante avec son père, et ce dès sa naissance – qui rêvassait sur le rebord de sa vitre abaissée. Il n’a pas vu le coup venir. Rires et moqueries éclatent sur le dos du garçonnet piqué au vif, déclenchant les aboiements déchaînés des chiens. Mais l’agitation et les pleurnicheries ne couvrent même pas le grincement suraigu des griffures sur la carrosserie, ni le frottement du châssis sur la crête que forment les deux ornières que nos roues contribuent à creuser. Clifford, menton sur le volant et yeux rivés sur le bout du capot, augmente le régime du moteur pour maintenir l’adhérence et nous éviter un numéro d’équilibriste : même s’il était possible de pousser un tel véhicule, nous ne pourrions nous en extraire que par les fenêtres !
La sortie est en vue. Nous nous extirpons de l’étreinte végétale, et le soleil aveuglant inonde à nouveau l’habitacle. Devant nous, une plaine de Spinifex étend son tapis vert-de-gris aux notes bleutées. Mes pensées naviguent sur ce sentier qui s’éloigne et plonge derrière l’horizon comme un sillage orangé sur une mer étale.
Pan ! La déflagration claque comme un fouet. Mes oreilles sifflent. Du fusil s’élève une volute de fumée. Le canon posé sur le rétroviseur extérieur, Clifford ajuste son deuxième tir, qui soulève un nuage de sable près de la queue d’un marlu sérieusement inquiet de ses chances d’en réchapper. Ce kangourou roux se trouve à 300 mètres environ. D’un bond agile, notre repas décanille sans réclamer son reste et disparaît. Comme il est trop tard pour le recharger, Clifford passe son fusil aux enfants et enclenche la première sans mot dire. Grommellements et messes basses à l’arrière. Tous retirent leurs doigts de leurs oreilles : j’étais manifestement le seul à ne pas avoir repéré le kangourou. Je comprends enfin le regard absorbé de Clifford depuis que nous nous sommes engagés sur cette piste : concentré sur la conduite, il scrute sans répit chaque recoin du bush à l’affût d’un gibier providentiel. Le Clézio décrivait une pareille acuité visuelle chez l’homme du désert, “capable de suivre les nuances, d’apercevoir les détails, de repérer une ombre fugitive, un reflet, un souffle”.
La demi-heure qui suit voit défiler une piste sans variations majeures. Puis, au détour d’une colline, le Spinifex devient épars et le sable virant au blanc dévoile les méandres de la De Grey. Au loin, son embouchure se confond avec le ciel et l’océan Indien. Des ornières sinueuses nous mènent au cap Condon – nommé Walalngunya par le peuple nyangumarta – barré par une mangrove impénétrable. Alors que nous gravissons le bref promontoire surplombant cette barrière naturelle, la perspective qui s’ouvre nous invite au silence. La baie dévoile sous nos yeux sa gradation de teintes allant du turquoise au céruléen. L’embouchure, son poumon, se gonfle du flot des marées.
Arrivées avant nous, deux familles sont déjà assises à l’abri du vent, entre les voitures disposées en arc de cercle. Une dizaine d’enfants sont présents. Je remarque une nette différence dans leur attitude : ils paraissent plus calmes et détendus qu’ils ne le sont en classe. Il y a notamment Florita avec sa silhouette gracile, ses yeux larges mais fuyants et ses dents du bonheur. Certains se démarquent naturellement, comme Joshia, ou bien Kimarl avec son épaisse chevelure ébouriffée d’un noir de jais. Comme nous tous, il semble apaisé par l’endroit, lui qui d’ordinaire traîne son air renfrogné. Il ne faut pourtant pas s’y fier : j’ai rarement décelé autant de bienveillance chez un enfant.
L’heure n’est pas au repos : le temps file et le soleil étire les ombres. Clifford distribue des consignes à tout le monde avant que la nuit ne nous surprenne. Le problème du dîner n’étant pas résolu, il s’installe au volant de son Prado, le fusil calé entre les genoux. Avant de repartir, il me charge de collecter une quantité de bois capable d’alimenter un brasier. Puis il me met en garde à propos des sites interdits avec un ton qui dissuade toute velléité de désobéir : “Ne t’aventure pas vers ces arbres, dit-il en pointant un bosquet éloigné, c’est un lieu pour les femmes. L’esprit-enfant habite cet endroit et féconde les mères qui le visitent. Sinon, tu as le droit de gravir cette butte sableuse et d’observer ses flancs jusqu’au sentier qui le contourne, mais tu ne dois pas mettre un pied au-delà de cette limite car c’est un site cérémoniel réservé aux hommes.”
Selon ses recommandations, ma liberté de mouvement se réduit aux plages ainsi qu’à une colline offrant une vue imprenable sur les environs. Puis-je espérer mieux que cette quarantaine ? Dans ce coin de paradis, une telle contrainte se transforme en privilège, de mon point de vue tout du moins. Car, même si la tradition s’est assouplie et adaptée à notre époque, une croyance aborigène toujours en usage dit qu’un étranger ou un individu qui se hasarde aux abords des sites réservés aux personnes du sexe opposé risque de tomber malade et de mourir, ou bien s’expose à un châtiment sévère. Jadis, enfreindre ces règles était ainsi puni de mort si l’intrus agissait à dessein. Personnellement, je n’ai aucun désir de franchir les limites qui me sont imposées, même si je doute qu’un sort funeste me soit réservé. En qualité de Yatilypa, Clifford m’a placé sous son égide et sa parole fait autorité. M’ayant confié à Lizzie, il repart avec deux de ses fils, Elysah et Creysley, bien décidés à nous faire oublier l’épisode du marlu manqué. L’inventaire des vivres embarqués leur laisse de toute façon peu le choix. Parmi les swags et les couvertures, je ne remarque rien de consistant pour soulager l’appétit d’une quinzaine d’ogres, n’étaient les aliments de base auxquels je pouvais m’attendre : un sac de farine blanche, des sachets de thé noir, du sucre et une boîte de lait en poudre. Il ne s’agit pas d’une négligence de leur part, mais plutôt d’un excès de précautions de la mienne. La nourriture foisonne dans la nature. Avant de former une jeune équipe pour la recherche de bois sec, je fais repartir le feu de Jackson, un vieil oncle de Clifford avare de conversation. Emmitouflé dans une chemise épaisse et les pieds fourrés au chaud sous son chien endormi, il murmure au vent une foule d’histoires qui me sont incompréhensibles. Par respect, je devance ses envies en faisant chauffer l’eau du thé et en l’installant confortablement, car depuis plusieurs semaines la saison du wantajarra fait chuter les températures dès que le crépuscule étouffe les derniers rayons.
Deux heures se sont écoulées et le retour tardif des chasseurs fait régner l’ennui autour du feu. “Ils ont probablement dû étendre leur zone de chasse”, confie Lizzie, rompant un long silence. Elle se montre pessimiste sur nos chances de manger du marlu ce soir, car la saison peu généreuse en pluies confine les grands marsupiaux à proximité des sources d’eau permanentes. À peine nous fait-elle part de ses doutes que des hoquets charriés par le vent retentissent dans la nuit opaque. Au terme de minutes interminables, deux phares oscillent à travers la plaine, accompagnés du couinement des amortisseurs. Le Prado débouche au détour de la colline et se dirige vers nous, projetant soudainement nos ombres sur les acacias qui encadrent le camp. Les enfants hurlent de joie à la vue d’une masse sombre attachée sur le capot et, tandis qu’ils se précipitent à sa rencontre, Lizzie tisonne les braises afin de ranimer le feu.
L’instant suivant, un oiseau s’abat lourdement à mes pieds, faisant voler plumules et duvet. La carcasse gisante pointe sur moi son œil torve qui exprime toute la soudaineté de la mort. C’est une jarrki, une magnifique outarde australienne, haute d’un bon mètre cinquante et au plumage blanc éclatant qui, lorsqu’elle ne succombe pas sous le feu nourri des carabines, arbore un long cou qui domine la plaine : une invitation pour le chasseur ! Quand elle ne croise pas un groupe d’Aborigènes, elle mène une existence paisible et sans prédateurs.
— C’est une cible inratable, m’explique Clifford, indifférente aux balles qui pleuvent autour d’elle. Elle ne s’échappe jamais. Tu as le temps de recharger, de te préparer une prise de tabac et de lui en mettre une autre si la première n’a pas suffi.
Une prouesse tout de même, dans cette nuit où la lune ne permet guère de distinguer le vivant de l’inerte. Selon moi, son mérite est intact ; un estomac vide ne s’encombre pas de considérations morales. À en juger l’enthousiasme ambiant, cette alternative au marlu n’en est pas moins un morceau de choix. Lizzie ramasse la bête par le cou pour la dénuder. À la lueur du feu brasillant, elle exécute une plumaison précise, rapide et qui dévoile l’orifice sanglant à l’origine du trépas. Son doigt fouille consciencieusement la chair rose mais, la balle restant introuvable, Lizzie poursuit la préparation de la jarrki sur le tas de rémiges blanches aux pointes noires et de duvet couleur d’albâtre. Sous les regards affamés, elle arrache les abats à pleines mains puis roule l’oiseau sur les braises afin de le débarrasser des plumettes rebelles. Une délicieuse odeur de chair roussie se répand alors dans le camp. Si certains repas sont uniquement constitués de végétaux, celui-ci sera fait de viande : le guwiyi. Ce festin doit certainement ressembler aux repas uniques pris jadis au crépuscule, qui couronnaient la journée passée à collecter et à grignoter des fruits et les délicieuses wuukarta – les fourmis à miel.
Les braises rougies annoncent le début de la cuisson à l’étouffée. Sachant qu’il faudra être patient, Joshia se rapproche de moi comme s’il voulait prendre part à mon apprentissage. Ainsi qu’à chacun des individus adultes réunis ce soir, un rôle m’est attribué. Clifford me tend une pelle afin que je creuse près du waru – le feu – un trou assez profond pour ensevelir l’oiseau. Ma tâche terminée, Lizzie se charge d’en tapisser le fond de braises, puis d’une couche de sable chaud pour éviter de calciner la chair. Clifford y place soigneusement la jarrki entière qu’ensuite, inversant la technique initiale, il recouvre de sable et enfin de braises. Des piétinements sur le monticule fumant achèvent de constituer ce four rudimentaire. Une cuisson lente et à cœur, qui rappelle les pratiques des Maoris, des Mapuches et des Bédouins pour les outardes. »
(p. 118-127)
L’ère des derniers arpenteurs (p. 33-38)
Punmu, le grand rassemblement (p. 173-177)
Extrait court


