La maison d’édition et la librairie des voyageurs au long cours
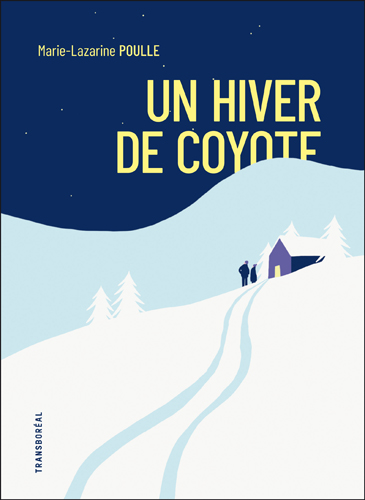
Interview : Marc Terrisse
À vélo à São
Dans votre livre, vous expliquez que c’est Jean-Yves Loude qui vous a incité à devenir écrivain-voyageur. En quoi vous a-t-il inspiré ?
J’ai découvert Jean-Yves Loude à travers son livre Lisbonne, dans la ville noire. Lorsque j’ai parcouru ce récit très littéraire conçu à la manière d’une enquête, j’ai tout de suite été touché par la manière dont il valorisait la diaspora africaine largement ignorée par la société lusitanienne. J’ai eu l’impression de découvrir une nouvelle façon de faire des sciences humaines. En séjournant dans la capitale portugaise peu après l’avoir lu, j’ai eu l’idée d’écrire Lisbonne, dans la ville musulmane, analogie évidente avec son travail sur l’africanité lusophone. J’ai tenté de reprendre les codes instillés par cet auteur que je n’ai rencontré que bien plus tard, deux ans après la sortie de mon premier opus d’écrivain-voyageur. Cette rencontre fut un moment empli d’émotion, celle d’un maître qui ignorait avoir fait des émules. Nous avons depuis des contacts réguliers.
Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez entendu parler de São-Tomé-et-Príncipe ?
C’est en m’intéressant aux personnages historiques africains que j’ai entendu parler pour la première fois de São-Tomé-et-Príncipe. L’histoire de l’archipel fait écho à celle d’Amador, qui était à l’origine d’une révolte d’esclaves intervenue au XVIe siècle contre le pouvoir portugais. Amador est un véritable héros national, une figure quasi mythologique de la jeune nation santoméenne post-coloniale. Je souhaitais à l’origine réaliser sa biographie, mais devant le peu de sources à disposition, j’ai préféré élargir mon sujet aux Angolares, et à d’autres aspects culturels de l’archipel. Je me suis alors rendu compte que le pays présentait une richesse insoupçonnée sur bien des plans.
Vous avez parcouru l’archipel à vélo : en quoi ce mode de transport a-t-il influencé votre perception du voyage ?
Quand on circule à vélo, on goûte aux paysages, on savoure chaque effort et on apprécie les endroits que l’on traverse à leur juste valeur, en prenant le temps. Le cyclotourisme permet d’entrer aisément en contact avec les habitants. On devient une sorte d’objet de curiosité, surtout à São-Tomé-et-Príncipe, où très peu de cyclistes circulent sur les routes. Je me souviens de certaines dames qui m’encourageaient dans les côtes, de gamins qui m’applaudissaient et même de badauds qui m’arrosaient avec de l’eau pendant les journées les plus chaudes. Une fois arrêté, mon vélo ne manquait pas d’intriguer. C’était un bon moyen d’entamer des conversations et d’en savoir plus en retour sur le quotidien des Santoméens.
Quel aspect de l’archipel vous a particulièrement marqué ?
Ce sont les Santoméens qui m’ont le plus marqué. Ils ont su conserver une sympathie désintéressée et un sens de l’hospitalité qui fait plaisir à voir. Sur le plan culturel une sorte de syncrétisme entre l’Afrique et l’Europe : le tchiloli, théâtre chanté qui puise ses racines dans le Portugal d’autrefois, est à ce titre assez éloquent. La musique et la gastronomie santoméenne sont également pleines de ces métissages culturels. Enfin, malgré une histoire douloureuse marquée par l’esclavage et des difficultés économiques, on n’hésite pas à prendre la vie du bon côté. J’ai notamment rencontré beaucoup de Santoméens qui font preuve d’un dynamisme et d’un optimisme à toute épreuve, notamment des artistes qui inventent des centres culturels autogérés et autofinancés tout à fait remarquables. Leur courage et leur abnégation forcent le respect et l’admiration.
Quel récit de voyage recommanderiez-vous pour découvrir cette région du monde ?
J’ai beaucoup apprécié le livre de Michel Tournadre São-Tomé et Príncipe, j’en ai d’ailleurs fait un fil d’Ariane pour mon périple. Il s’agit d’un livre de photos agrémenté d’un texte très personnel sur une terre qui lui est chère. Néanmoins, l’archipel reste méconnu et très peu d’auteurs francophones y sont allés. Il faut se tourner vers le monde lusophone, mais les récits datent le plus souvent de l’époque coloniale et comportent des biais, ceux d’un nationalisme naissant ou d’un regard occidental empreint de préjugés ou de velléités politiques. Reste la poésie, très présente à São Tomé-et-Príncipe à travers des auteurs comme Francisco José Tenreiro ou Alda do Espírito Santo, tous deux figures tutélaires de cet art qui demeure le meilleur moyen de voyager dans l’archipel.
Questions préparées par Claire Dufaure
Archives des interviews



